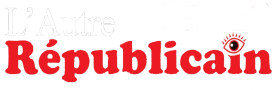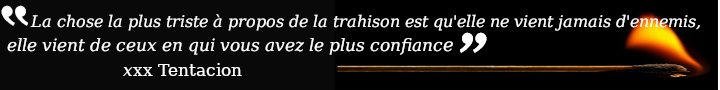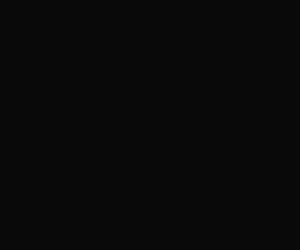L’ordonnance n°2025-27 du 14 août 2025, relative à la discipline des magistrats pendant la période de la Refondation, ouvre un débat fondamental sur l’avenir de l’État de droit au Niger. En conférant au Chef de l’État et Général d’armée, le pouvoir de décider de mesures contre les magistrats pour des faits présents ou antérieurs, cette ordonnance impose une logique de commandement militaire à un corps dont la raison d’être est, par essence, la défense de la loi, de la liberté et des citoyens.
Cette ordonnance est un exemple typique du règlement disciplinaire militaire, qui repose sur l’obéissance absolue et le silence hiérarchique, valeurs totalement étrangères à l’indépendance de la justice. Elle viole aussi un principe essentiel en droit sur la rétroactivité des lois : une loi n’est rétroactive que lorsqu’elle confère des avantages aux individus. L’article 22 de la Charte de la Refondation, qui tient lieu de Constitution, promulguée par le général Tiani, lui-même, ne dispose t-il pas que ; « les lois et règlements n’ont d’effet rétroactif qu’en ce qui concerne les droits et avantages qu’ils peuvent conférer au citoyen » ?
Cette ordonnance intervient après un bras de fer désamorcé entre le gouvernement et les magistrats militants du Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN), dissous dans la douleur, mais soutenus par des Centrales syndicales, le Barreau, des organisations de la société civile ainsi que par des défenseurs des droits humains aux plans national, régional et international.
Or, selon les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par les Nations Unies en 1985, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, en son article 10, tout individu a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, dans sa jurisprudence, a maintes fois rappelé que l’indépendance judiciaire est la pierre angulaire d’une société démocratique.
Une loi, par définition, doit être générale, impersonnelle et non discriminatoire. Lorsqu’elle vise exclusivement une catégorie de citoyens pour les « mettre au pas », elle devient une loi d’exception et porte en elle les germes d’une loi dite scélérate. L’histoire retient que de telles lois, loin de renforcer l’autorité, fragilisent plutôt le pouvoir qui les promulgue, en ternissant son image aux plans national et international.
Le principe est clair : « Nullum crimen, nulla poena sine lege », qui signifie « Nul crime, nulle peine sans loi », consacré par l’article 11-2 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Autrement dit, une loi ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation. Introduire la rétroactivité dans un dispositif répressif, c’est transformer la loi en un instrument de vengeance politique et une arme contre ceux qui osent défendre leurs droits.
Toute gouvernance sans contre-pouvoir est une aventure risquée. L’histoire universelle enseigne qu’un pouvoir sans frein se transforme rapidement en arbitraire. L’absence de contrepoids institutionnels engendre la corruption, l’abus de pouvoir, la répression et, in fine, l’effondrement de la confiance entre gouvernés et gouvernants. Montesquieu, dans L’Esprit des Lois, avertissait déjà : « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. » C’est pourquoi la justice, la presse, les syndicats, la société civile et les organisations internationales constituent des garde-fous, des contre-pouvoirs indispensables.
En cherchant à discipliner les magistrats au moyen d’une ordonnance à effets rétroactifs et d’un pouvoir présidentiel discrétionnaire, le régime en place envoie un signal inquiétant, qui est celui d’un État qui glisse vers l’autoritarisme.
Mahamadou Tahirou