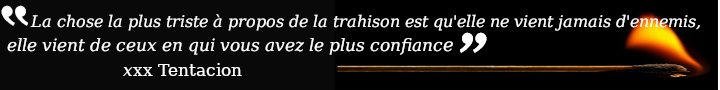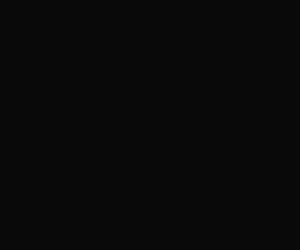Rahmane Idrissa est docteur en sciences politiques, originaire du Niger où il dirige un think tank en économie politique. Il a développé une expertise sur l’intégration africaine dans la longue durée au cours d’un double fellowship à Oxford et à Princeton. Il est l’auteur du Historical Dictionary of Niger (Scarecrow Press, 2012). Il est également Chercheur senior au Centre des études africaines de l’Université de Leyde et maître de conférences en science politique à l’Africa Institute de Sharjah. A travers cette interview, il décrypte l’an I de l’AES, le retrait des 3 pays de l’AES de la CEDEAO et le nouvel ordre au Sahel.
L’Autre Républicain : La semaine dernière, l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a fêté son premier anniversaire. Conçue pour lutter contre le terrorisme, l’AES a élargi son mandat à la diplomatie et au développement. Quel bilan peut-on dresser après une
année d’existence ?
Rahmane Idrissa : Au bout d’un an, elle reste plus proche du rêve que de la réalité. L’idée de départ, l’entraide pour lutter contre les djihadistes, est bonne et d’ailleurs n’est pas nouvelle. Les trois pays avaient déjà essayé de se rassembler autour de l’Autorité du Bassin du Liptako-Gourma, en imitation de la manière dont le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun ont essayé de coopérer autour de la Commission du Bassin du Lac Tchad, avec des résultats intéressants. Mais un tel véhicule d’entraide est difficile à mettre en place avec les moyens dont disposent ces régimes. Les efforts précédents étaient en partie soutenus financièrement par des appuis extérieurs. Sans argent, l’AES reste une entité abstraite qui a surtout des effets psychologiques. Elle permet à certains des habitants des pays de se sentir fiers, de se sentir des Sahéliens par opposition aux non-Sahéliens. Et elle donne l’impression aux régimes et à leurs soutiens qu’ils sont en train d’aller quelque part.
Et effectivement, alors même que la problématique sécuritaire n’est pas résolue, on parle de développement. Quand on est dans le rêve éveillé, tout paraît possible, je suppose. Dans la réalité, nous voyons les trois pays les plus désavantagés de la région (10% seulement du PIB ouest-africain, les IDH les plus bas du monde) qui doivent mobiliser les énergies, les capitaux, les compétences et la volonté politique nécessaires pour une intégration pour le développement tout en exécutant les difficiles réformes de gouvernance requises. Le tout dans un contexte de crise multidimensionnelle, à la fois sécuritaire, économique et politique pour la résolution de laquelle ils refusent de travailler avec leurs voisins et la communauté internationale. Quelle chance cela a-t-il de marcher ?
La plus grande déception se trouve au plan sécuritaire. Les régimes AES n’ont pas réussi à mettre en place une politique sécuritaire. Rétrospectivement, cela n’a rien de surprenant, car il s’agit de régimes militaires et une politique sécuritaire ne peut pas être élaborée juste par l’armée. Il s’agit d’un montage complexe d’actions et de mesures avec plusieurs segments mobiles, dont certains sont en effet militaires, mais d’autres sont politiques, économiques, sociaux, voire culturels. Le régime renversé du Niger avait développé par essais et erreurs une doctrine intéressante à ce sujet. Je pense que si le Mali et le Burkina Faso avaient fait de même et que les trois pays s’étaient alliés dans ces conditions, tout en travaillant avec les bonnes volontés régionales et étrangères, la crise sécuritaire serait aujourd’hui derrière nous. Tels qu’ils sont constitués, c’est-à-dire avec une dominante militaire, les régimes AES ne peuvent arriver à un tel résultat. Ils ne se servent que du segment militaire de la machine. C’est un peu comme si vous voulez éteindre un incendie seulement avec des pelles, en négligeant les extincteurs, les lances à incendie et les drones à infra-rouge.
L’Autre Républicain : Les juntes qui dirigent les trois pays ont décidé du retrait de leurs États de la Cedeao. Quel avenir pour ces trois pays, à votre avis ?
Rahmane Idrissa : La décision de retrait résulte de deux choses : l’idéologie isolationniste des régimes AES et surtout, détail plus décisif, l’arrogance particulière et le manque fréquent d’empathie des élites africaines vis-à-vis de leurs populations.
Vous voyez que la décision de retrait a été doublement unilatérale : la Cédéao a reçu la notice de départ sans préavis et la population n’a pas été consultée. Ce double mépris est cohérent. La Cédéao, aurait dit le président Tandja, un politicien qui annonce par bien des côtés la psychologie des régimes actuels, ne sert à rien. En effet, elle ne sert à rien du point de vue des élites. Elle a partie liée avec les populations, pas avec les élites.
Les pays du Sahel, comme la plupart des pays africains, vivent sur deux économies, l’économie réelle, dont dépendent la majeure partie de la population ; et l’économie officielle, dont dépendent les États. Les deux économies sont peu connectées. L’État fait bien quelques prélèvements sur l’économie réelle au titre des impôts, taxes et redevances douanières, mais il tire l’essentiel de son revenu du rendement fiscal des produits d’exportation, essentiellement des matières premières minières et agricoles. De ce fait, les dirigeants ne se sentent pas redevables à l’endroit de la population, ce qui explique pourquoi l’essentiel des politiques de production de biens publics est délégué à l’aide internationale. Il n’y a pas de contrat social, et pas d’intérêt général. Les populations sahéliennes n’attendent pas des États qu’ils les aident à mieux vivre, mais elles attendent d’eux qu’ils ne les empêchent pas de chercher à mieux vivre, notamment en s’engageant dans cette quête du mieux-vivre que les langues du Niger appellent néma, tchétchi. Cette quête se fait dans l’économie réelle, qui dégage des capitaux et revenus essentiellement à travers le commerce d’import-export, la migration circulaire sous-régionale et un processus de diasporisation dans les pays du Golfe de Guinée, du Nigeria à la Côte d’Ivoire.
Or, si la Cédéao ne sert pas à grand-chose du point de vue des économies officielles de l’Afrique de l’Ouest, elle est une immense valeur ajoutée du point de vue de l’économie réelle. En gros, elle enlève les États des pattes des populations, elle permet à ces dernières de se chercher plus facilement, et cela s’applique tout particulièrement aux populations sahéliennes. Le retrait imposé par les régimes AES remettra l’État dans les pattes de ces populations, et cela au plan des barrières officielles comme du point de vue des harcèlements liés à la gouvernance parallèle corruptive qui est si développée en Afrique. Il ne faut pas imaginer que les choses resteront comme elles sont en ce moment, d’autant plus qu’on se dirige vers un retrait sec, sans le lubrifiant de négociations et de nouveaux accords de coexistence entre sortants et restants.
Mais comme je l’ai dit, les élites dirigeantes vivent dans un monde différent, qui les prive ou les dispense d’empathie à l’égard des populations. De leur point de vue, il n’y aura pas d’impact. Le processus d’intégration économique de la Cédéao, qui postule une fusion des économies officielles autour d’une politique agricole et industrielle communes, est en panne depuis des décennies. Donc l’économie officielle des pays sahéliens est autonome, et par ailleurs, les élites n’ont pas à cœur de la développer. Toute petite qu’elle soit, tant qu’elle produit assez de rentes pour garantir leur maintien aux affaires, tout leur paraît tenir la route et l’avenir ne leur fait pas peur. Il faut voir que l’isolationnisme a déjà sinistré les économies réelles du Sahel au-delà même de ce que l’embargo de la Cédéao a pu infliger au Mali il y a quelques années, et cela ne les dérange pas le moins du monde.
Des conséquences politiques restent possibles à court et moyen termes. Les populations acceptent dans leur majorité les pouvoirs militaires actuels parce que le changement de pouvoir n’a aucune conséquence dans leur vie. Les pouvoirs civils ne savaient pas améliorer leur sort et les négligeaient pour l’essentiel, et il en est de même des pouvoirs militaires. Mais si ces derniers provoquent une crise grave de l’économie réelle du fait de la sortie de la Cédéao, une colère populaire pourrait naître contre eux. Les gens pourraient dire : « Non seulement tu ne m’aides pas, mais tu veux m’empêcher de m’aider moi-même ».
À cet égard, l’un des problèmes politiques sérieux des régimes AES, c’est leur rejet radical de la démocratie. La démocratie peut exister de façon subalterne dans un régime autoritaire. On peut avoir un régime qui est formellement autoritaire, c’est-à-dire qui ne possède pas des institutions démocratiques, mais qui pratique un peu de démocratie de façon informelle, c’est-à-dire en mettant en place des canaux de communication non-institutionnels à travers lesquels il reçoit le feed-back et le ressenti de la société, ce qui lui permet de les prendre en compte dans ses décisions. Mais les régimes AES ne veulent de « communication » que de façon unidirectionnelle, c’est-à-dire qu’ils veulent que la société les écoute et fasse écho à leur discours, et puis ça s’arrête là.
Les régimes renversés, bien que brutalisant souvent les normes démocratiques, possédaient ces canaux de « feed-backing » aussi bien au plan formel qu’informel, et cela impactait leurs décisions. Il n’en est pas de même des régimes AES. Pourquoi ? Sans doute parce que ces derniers reposent sur une combinaison très particulière, le pouvoir militaire + l’idéologie, celle qui se dit panafricaine en l’occurrence. Le pouvoir militaire, qui relève du commandement, a du mal à écouter et à entendre ; et l’idéologie est structurellement autiste.
L’Autre Républicain : La quête de la souveraineté et le patriotisme sont mis en avant par ces juntes pour justifier leur prise du pouvoir. Quelle est votre
lecture de ce nouveau mot d’ordre au Sahel ?
Rahmane Idrissa : Je pense qu’il faut distinguer entre souveraineté et souverainisme. La première est une pratique, la seconde, un discours. Je dirais que dans l’ère AES, le discours souverainiste est très bruyant et cela se traduit par des actes. Mais ces actes ne correspondent pas nécessairement à une pratique réelle de la souveraineté.
Le discours souverainiste AES a défini la souveraineté comme l’autonomie vis-à-vis du monde occidental, si bien qu’en pratique, il s’est traduit simplement par du dégagisme anti-occidental, et d’abord, bien-sûr, antifrançais. Ce dégagisme ne rompt pas les liens de dépendance avec l’Occident, mais il le renverse, au moins dans l’ordre du discours. Comme je l’ai mentionné auparavant, les États du Sahel ont généralement délégué la production de biens publics à l’aide internationale, qui est surtout occidentale. Les régimes AES n’ont pas changé cette donne, mais comme l’industrie de l’aide veut continuer à s’occuper des populations sahéliennes, ils postulent que cela crée une situation où ce sont en fait les aidants qui dépendent des aidés, et qu’ils peuvent donc leur imposer leurs conditions. Ils ont effectivement compris la première règle de l’aide dite au développement, à savoir préserver à tout prix l’accès aux nécessiteux. Les régimes contrôlent cet accès, donc l’aide dépend effectivement d’eux. Cela n’est pas nouveau, mais cette logique a été dissimulée, par le passé, par l’adhésion des dirigeants à des normes proposées par l’industrie de l’aide et qu’ils se sentaient tenus de respecter. Plus maintenant.
Comme ce souverainisme est déterminé par le rejet de l’Occident, il s’accompagne de l’instauration de nouveaux liens de dépendance avec une puissance qui se pose comme l’ennemie jurée de l’Occident, la Russie poutinienne. Il rejette aussi le droit à la souveraineté des pays voisins. Les régimes AES disent vouloir quitter la Cédéao parce que les pays Cédéao ont l’outrecuidance de maintenir des liens avec l’Occident, en particulier la France. De fait, ils ont, eux, le droit de s’allier à la Russie, mais ne reconnaissent pas aux autres le droit de s’allier à la France. Cette exigence provient du fait que, comme l’indique la désinence « isme », le souverainisme est une idéologie, et l’idéologie a besoin d’un ennemi. Les souverainistes du Sahel ont réservé ce rôle antipathique à la France et même parfois à l’Europe. Je dois ajouter que nous ne sommes pas ici en face d’une véritable idéologie, mais d’une idéologie en toc. L’idéologie véritable a des référents dans le réel. Ici, on nage généralement en pleine fiction.
Le souverainisme s’accompagne non pas tant du patriotisme que de ce qu’on pourrait appeler le « patriotardisme ». Le patriote cherche à faire le bien de son pays, généralement en toute discrétion et en reconnaissant les difficultés de la tâche. Le patriotard cherche à combattre les ennemis de son pays, en simplifiant de façon mélodramatique sa lutte, comme si elle opposait le Bien et le Mal incarnés. Le patriote reconnaît la complexité des intérêts collectifs et admet que d’autres, parmi ses compatriotes, peuvent voir les choses différemment de lui. Le patriotard réduit ces intérêts aux points qui l’opposent à ceux qu’il perçoit comme étant les ennemis de la Patrie et taxe quiconque ne pense pas comme lui de traître et d’apatride. Le souverainisme et le patriotardisme marchent main dans la main, et en ce moment, ils règnent en maîtres au Sahel.
L’Autre Républicain : La détérioration de la situation sécuritaire est le prétexte avancé par les trois juntes pour justifier leur intrusion sur le terrain
politique. Au regard de l’attaque terroriste à Bamako contre des cibles militaires et l’aéroport international, et des menaces ouvertes des groupes terroristes notamment le Jnim contre le Burkina et le Niger, quelle appréciation faites-vous de la situation actuelle ?
Rahmane Idrissa : Cette attaque, ainsi que le massacre de Barsalogho au Burkina, est le résultat de l’approche « tout-militaire » voulue par les régimes AES. L’intensification de la violence militaire et paramilitaire (milices au Burkina Faso, mercenaires au Mali) des régimes déclenche en retour l’intensification de la violence tactique et terroriste des djihadistes. L’idée d’éteindre le feu par le feu est contre-productive et comporte des risques immaîtrisables de propagation de l’incendie, mais comme je l’ai expliqué, de par leur constitution toute militaire, les régimes AES sont incapables de procéder autrement.
Ils procéderont d’autant moins autrement que les publics sahéliens adhèrent, en partie sur la base de l’idée naïve mais compréhensible selon laquelle dans un contexte de guerre, il faut faire aveuglement confiance aux militaires. Par exemple, au Burkina Faso, les populations qui se font massacrer idolâtrent cependant le « Président IB » et trouvent elles-mêmes des excuses à ses échecs. Au Mali, on peut imaginer ce qui se serait passé au temps de IBK si treize djihadistes avaient occupé l’aéroport de Bamako et massacré des dizaines de militaires en dépit d’un renforcement de la sécurité dû à des célébrations nationales. Dans le cas d’espèce, la population bamakoise a minimisé l’évènement tout en lynchant quelques membres d’une communauté ethnique dans les rues de la ville. Comment voulez-vous qu’il y ait du changement ?
Or, sans changement, la situation ne fera que s’aggraver. Le tout-militaire, c’est le principe de la guerre d’attrition, l’idée qu’en l’absence d’une disproportion de moyens telle que l’ennemi est immédiatement écrasé, comme ce fut le cas lors des guerres américaines contre l’Irak, il faut le faire saigner en acceptant de saigner soi-même, avec l’idée que celui qui saignera le plus perdra la guerre. Donc le principe des hécatombes de part et d’autre est accepté par les tenants de la guerre d’attrition, en l’occurrence, les régimes AES. Le problème, c’est que ce scénario s’applique dans le cas d’armées régulières de force à peu près équivalente. Il ne s’applique pas dans le cas d’affrontements entre une armée régulière et des guérilleros, comme le sont les djihadistes du Sahel. Ce qu’on voit, c’est que les armées au final ne font saigner que des civils pour la plupart, tandis que les djihadistes font saigner les armées et les civils qui les aident. Résultat, le temps joue en leur faveur.
L’Autre Républicain : Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les contre-pouvoirs traditionnels comme les médias et la société civile sont dans une
posture de renoncement à la défense de la démocratie et des droits et libertés humains en soutenant corps et âme les juntes. Cette situation presque inédite ne traduit-elle pas une crise de citoyenneté au Sahel ?
Rahmane Idrissa : Comme tout phénomène historique, la citoyenneté ne peut survivre que si elle devient une force établie, notamment en atteignant une masse critique dans un système politique donné. C’est pour cela, par exemple, qu’elle est si résiliente au Sénégal. Dans les autres pays sahéliens, son histoire est plus heurtée. À peine née en 1957, elle a été étouffée par le parti unique en 1960. Elle n’est réapparue qu’au début des années 1990, et normalement, la démocratisation et la décentralisation étaient favorables à son expansion. En devenant une réalité pour un nombre croissant de gens, elle pourrait atteindre la masse critique qui mettrait les pays à l’abri d’une rechute sous le joug autoritaire.
Mais il s’est produit un accident de parcours. Au lieu de propager la citoyenneté, la démocratisation a surtout stimulé le développement du phénomène partisan, c’est-à-dire l’attachement exclusif à un parti et l’établissement de régimes partisans dans lesquels ceux qui n’étaient pas de la mouvance au pouvoir étaient condamnés à être des citoyens de seconde zone. Les opposants, par réaction naturelle, se mirent à défendre aveuglement leurs intérêts partisans. Dans cette empoignade, ce que vous appelez contre-pouvoir était sommé de prendre parti. Le droit du citoyen est articulé à l’intérêt général, et il n’avait pas de sens dans un contexte où l’intérêt partisan l’emportait sur l’intérêt général. Bref, l’envahissant phénomène partisan a étouffé le développement de la citoyenneté comme la mauvaise herbe étouffe la bonne.
Ça, c’est le scénario global, que chacun des trois pays a suivi sur une trajectoire différente. En tout cas, vers la fin des années 2010, ils en étaient arrivés au même stade, une crise profonde de la citoyenneté. C’est au Burkina que cette crise était moins grave car ce pays a connu une insurrection citoyenne en 2014 et 2015. D’ailleurs, c’est le pays où la citoyenneté a le plus résisté à la mise au pas imposée par les régimes AES, et c’est aussi là-bas que la répression est la plus dure.
D’une manière générale, les défenseurs de la citoyenneté ont été pris de court. Que ce soit au Mali dans l’été 2020 ou au Niger au début du coup d’État de juillet 2023, ils ont cru que les événements allaient mettre fin à un régime partisan particulièrement odieux (« IBK », « Gouri ») et permettre une renaissance de la citoyenneté. Ils ne se rendaient pas compte qu’ils luttaient aux côtés de groupes qui avaient de tout autres visées, et une fois que ces derniers se sont saisis de la place, ils ont constaté toute leur faiblesse. En particulier, ils ont découvert qu’ils étaient dangereusement minoritaires, qu’il n’y avait pas de masse critique. Tant qu’on se trouvait dans le théâtre de la démocratie, on pouvait supposer que chaque acteur adhérait implicitement aux principes du droit du citoyen. Mais pour la plupart de ces acteurs, y compris ceux qui prétendaient jouer le rôle de contre-pouvoir, ce n’était que du conformisme, l’adhésion à l’air du temps. Aujourd’hui, le nouveau théâtre est celui du souverainisme, et il convient d’être non pas un citoyen, mais un patriote, ou plutôt, un patriotard. Les citoyens sincères soit s’exilent, soit se taisent, soit résistent de la manière qu’ils peuvent. Mais à vue de nez, une longue traversée du désert les attend à travers le Sahel intérieur.
Réalisée par Elh. M. Souleymane
L’Autre Républicain du jeudi 26 septembre 2024