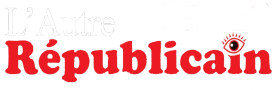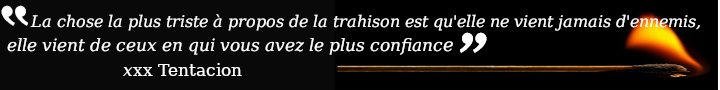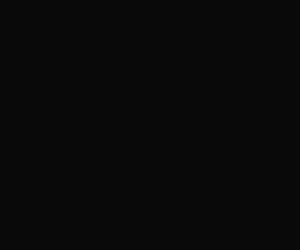Au Niger, la presse privée traverse aujourd’hui l’un de ses moments les plus sombres. Non pas seulement parce qu’elle est menacée dans son essence même, « la liberté d’informer » mais aussi parce qu’elle est acculée à une survie matérielle de plus en plus intenable. Le paradoxe est cruel, les journalistes, censés être les vigies de la démocratie et les relais des aspirations populaires, se retrouvent réduits au silence ou abandonnés à une précarité insoutenable, pendant que l’État semble se désintéresser totalement de leur sort.
Tout commence au lendemain du coup d’État du 26 juillet 2023. Alors que la junte militaire s’installe au pouvoir, la Maison de la presse du Niger, faîtière des organisations socio-professionnelles des médias, voit ses activités suspendues sans ménagement. Cette institution, créée pour défendre la liberté de la presse et plaider à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, avait été pendant des années le cadre de plaidoyer en faveur de salaires décents, du respect des droits sociaux, et d’un financement public plus conséquent pour les médias privés. Elle s’était aussi érigée en contrepoids face à l’hostilité souvent affichée de l’État vis-à-vis d’une presse jugée trop critique.
Mais contre toute attente, et avec la complicité silencieuse de certains acteurs du secteur, cette structure a été balayée d’un revers de main par le régime militaire. Aucune procédure, aucun débat contradictoire : la suspension fut brutale et totale. Dès lors, les journalistes de la presse privée ont commencé à ressentir les effets d’un isolement inédit. Interdits ou marginalisés dans la couverture de certains événements officiels, ils ont même entendu, de la bouche d’une autorité influente du régime, une phrase glaçante : « le gouvernement n’a pas besoin de la presse privée ». Tout était dit.
Le paradoxe, c’est qu’au moment même où la presse privée était fragilisée, jamais elle n’avait autant besoin de solidarité interne. Plusieurs voix s’étaient élevées pour exhorter les professionnels des médias à se serrer les coudes, à parler d’une seule voix pour exiger la réhabilitation de leur faîtière et pour peser dans le rapport de force. Mais au lieu de l’union sacrée, ce fut la dispersion, des calculs personnels, postures individuelles et illusions de négociations séparées voire du larbinisme ont brisé la cohésion tant espérée.
Résultat, aujourd’hui, la presse privée vit une descente aux enfers. Beaucoup de journalistes travaillent sans salaire depuis des mois, certains accusant même des arriérés qui dépassent une dizaine de mois. Les rédactions, déjà en difficultés pour certaines avant le coup d’État, ne savent plus comment payer les loyers, les frais de fonctionnement ou simplement imprimer leurs journaux. Les télévisions, les radios locales, jadis voix des campagnes et des périphéries, tournent sans ressources. L’information se raréfie faute d’annonceurs, la précarité s’installe, et le public nigérien perd peu à peu le bénéfice d’une presse diversifiée et critique.
Face à cette situation, certains journalistes sur « des braises » en appellent désormais à l’État pour qu’il vienne au secours des médias privés. Mais là encore réside le nœud du paradoxe. Comment un gouvernement qui a publiquement déclaré n’avoir aucun besoin de la presse privée, et qui lui a déjà retiré son principal organe fédérateur, pourrait-il aujourd’hui mobiliser des ressources pour la sauver ? Dans un contexte de coupes budgétaires, de retards de salaires même dans la fonction publique et d’une économie nationale fragilisée, les chances d’un tel soutien semblent illusoires. Pour les autorités actuelles, la presse privée n’est pas essentielle ; elle est perçue comme une gêne plus que comme un partenaire.
C’est précisément cette impasse que la Maison de la presse, avant sa suspension, voulait éviter. Elle plaidait pour une presse forte, unie, protégée par des mécanismes solides face aux aléas politiques et économiques. Mais ses avertissements sont restés lettre morte. Aujourd’hui, l’histoire lui donne raison, malheureusement au prix d’une réalité tragique pour les journalistes et pour la démocratie.
La leçon est claire : la survie de la presse privée nigérienne ne dépendra ni d’une manne providentielle de l’État, ni d’un miracle extérieur. Elle repose sur une seule alternative : s’unir ou périr. Seul un sursaut collectif, une union des forces, des énergies et des voix pourra redonner espoir à un secteur désormais au bord de l’asphyxie. Car une presse divisée est une presse condamnée, et une presse muselée est une société amputée de son droit à la vérité.
Mahamadou Tahirou