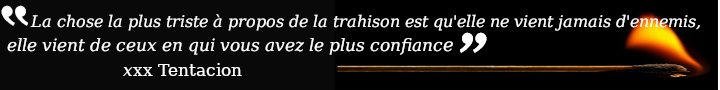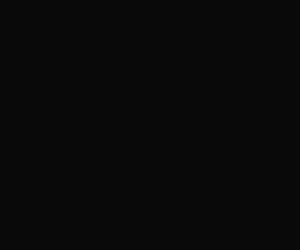Dans l’article qui suit, le politologue nigérien Rahman Idrissa nous plonge dans le dualisme permanent, ici et ailleurs, entre Autoritaires et Démocrates, entre démocratie et autoritarisme. Il explique que la démocratie est un régime moral, l’autoritarisme, un régime moralisateur. La première repose sur des vertus politiques, le second sur des prescriptions dépolitisatrices. Il épingle le comportement des élites politiques africaines qui peinent à assumer leurs rôles. Cette situation est bien illustrée par le putsch avorté au Bénin, le 7 décembre dernier. L’accueil réservé à cet événement au sein de l’opinion publique ouest-africaine, et en particulier au Sahel central fait interroger.
La tentative de putsch au Bénin a été accueillie dans l’opinion publique ouest-africaine par des réactions qui reflètent bien la division de la région entre Autoritaires et Démocrates qui s’est imposée à la faveur, en particulier, des coups d’État du Sahel – division confuse, point nettement tranchée, mais dont le sens se clarifie parfois sous la pression des évènements. Jusqu’à présent, les Autoritaires avaient le vent en poupe. Après leur défaite d’il y a trente ans, lorsque la vogue (ou la vague ?) démocratique avait renversé les régimes militaires du Sahel et contraint tous les régimes autoritaires subsistants à mettre une dose adoucissante de démocratie et de libéralisme dans leur âcre potage, les Autoritaires avaient été apparemment condamnés à une traversée du désert dans laquelle ils devaient ronger leur frein. Mais les choses étaient, naturellement, plus compliquées que cela.
L’autoritarisme et la démocratie sont des méthodes plutôt que des régimes en tant que tels. Ce sont des méthodes sur un spectre de gestion du pouvoir – ce dernier terme devant être distingué de la gestion des intérêts sociopolitiques. La gestion du pouvoir renvoie à la politique, la gestion des intérêts sociopolitiques à la gouvernance. Le pouvoir, bien sûr, est un intérêt : mais un intérêt personnel ou factionnel et qui est censé être un moyen plutôt qu’une fin ; les intérêts sociopolitiques sont impersonnels et généraux. Le premier est souvent l’intérêt d’un parti ou d’un clan ; les seconds, ceux d’une profession, d’un secteur de l’économie, d’un groupe social, etc.
Plus la méthode autoritaire prévaut en politique, plus le régime est autoritaire ; et plus la méthode démocratique est en usage, plus le régime est démocratique. La méthode est à la fois culturelle et institutionnelle – ou, si l’on préfère, informelle et formelle. On peut avoir des institutions formellement démocratiques, mais dans un climat informel dominé par les méthodes autoritaires. Les raisons d’un tel résultat sont complexes. Il y a des cas où ils dérivent de l’émergence d’une faction d’Autoritaires au sein d’institutions formellement démocratiques : c’est ce qui se passe, en ce moment, aux États-Unis. Dans certains autres cas, ce résultat découle du fait que des institutions démocratiques ont été imposées à une faction d’Autoritaires, comme ce fut parfois le cas en Afrique au tournant des années 1990 – et cette faction parvient à résister de façon plus ou moins efficace à l’assaut mené contre son pouvoir. On peut penser aux différents régimes d’Afrique centrale, qui ont généralement réussi à court-circuiter lesdites institutions et à les vider de tout sens ; ou, en Afrique de l’Ouest, au Togo – qui semble être un régime d’Afrique centrale transplanté en Afrique de l’Ouest – ou au Burkina Faso sous Blaise Compaoré, dont les tactiques ont finalement échoué en octobre 2014. Plus rares sont les cas où des institutions autoritaires permettent l’exercice de la méthode démocratique, ne serait-ce que dans une certaine mesure. Au moment où j’écris ceci, aucun exemple convaincant ne me vient à l’esprit.
Parfois, une gestion autoritaire du pouvoir politique peut se justifier à travers une gestion efficace des intérêts sociopolitiques. Beaucoup de gens, et pas seulement en Afrique, voient un lien de cause à effet entre autoritarisme et bonne gouvernance. C’est la raison invoquée par les premiers dirigeants postindépendance pour liquider les institutions et la méthode démocratique expérimentées dans les dernières années de la colonisation, aussi bien dans les territoires britanniques que français. Le développement requiert, dirent-ils, l’unité d’action, qui se fonde sur l’exclusion autoritaire de tous ceux qui ne veulent pas adhérer à ladite unité. Ces dirigeants furent un premier exemple du type « développementaliste autoritaire » incarné aujourd’hui par Paul Kagamé, au Rwanda.
Au Bénin, Patrice Talon – qui est plus un doctrinaire du développement que ne le sont d’habitude les politiciens ouest-africains – a emprunté cette voie de façon ambiguë : dans le contexte d’un pays dominé depuis des décennies par la méthode démocratique et n’ayant pas connu le type de violence qui a amené au pouvoir le chef de guerre qu’était Paul Kagamé, il ne pouvait pas agir avec la brutalité radicale de Kagamé. Il a plutôt essayé l’approche « main de fer dans un gant de velours ». Les sensibilités béninoises – un grand nombre d’entre elles – ont surtout senti la main de fer. Le Bénin a connu, sous Talon, des réussites de gouvernance qui ne semblaient même pas à l’horizon des gouvernements précédents – impulsant des transformations peut-être plus frappantes pour des gens comme moi qui voyagent dans le pays sur de longs intervalles que pour ceux qui y vivent et ne les ressentent que de façon très graduelle et pratiquement insensible, sauf quand ça leur fait mal. Dans le contexte particulier de l’Afrique, où l’instrument de la gouvernance – l’État – est généralement très faible (dans son degré d’organisation comme dans les aptitudes et l’éthique de son personnel), ce genre de changements se font plus à travers la politique qu’à travers l’État. Or l’impact des manœuvres politiques, qui ont toujours en elles quelque chose de non-légitime et de clivant, est plus sensible que celui des routines administratives. Il faut dire aussi que dans bien des cas, les opposants sont tout autant à blâmer que ceux qui sont au pouvoir. Bien entendu, ces derniers sont plus visibles et disposent naturellement de plus de moyens d’action, ce qui les met davantage sur la sellette. Mais je me rappelle avoir entendu un ministre nigérien du temps de la démocratie expliquer qu’il aurait bien voulu intégrer des opposants à ses services : malheureusement, ces derniers, une fois dans la place, ne cherchaient plus que les moyens de saboter son action pour rendre service à leur camp.
D’ailleurs on ne doit pas s’attendre à ce que les opposants, une fois arrivés au pouvoir, se conduisent avec plus d’intégrité dans le respect des règles du jeu. Au Bénin, de nombreux opposants, incapables de mettre au point une stratégie capable de prendre Talon à son propre jeu, rêvaient d’une intrusion militaire comme solution ultime à leur frustration. Leur échec était pourtant plus dû au fait qu’ils étaient de mauvais politiciens qu’aux actions mêmes de Talon – et la mesure de leur incompétence se trouve dans leur incapacité à générer une adhésion populaire de masse et à se construire une large base militante que Talon aurait été contraint de respecter. Il faut les comparer par contraste avec le PASTEF au Sénégal dont les patrons ont su travailler à la mobilisation d’une base militante et citoyenne assez large et ardente pour résister à un chef d’État hostile aux ambitions troubles. Il faut aussi les comparer aux politiciens du Sahel central, en particulier du Niger et du Burkina Faso, qui sont restés prisonniers de leurs petites manœuvres d’appareil et se sont trop reposés sur la logique des fiefs électoraux, en négligeant l’approfondissement et la massification des militants – si bien que le moment venu, ils ont été balayés comme fétu de paille par les militaires sans que cela ne suscite le moindre frémissement dans l’opinion publique. Si Talon avait été renversé au Bénin, je gagerais que le sort de la classe politique béninoise aurait été identique : ceux qui rêvaient d’un pouvoir militaire rêvaient, de fait, de leur propre trépas politique.
Pour en revenir à mon propos, les Autoritaires sont ceux qui rejettent la méthode démocratique ou qui n’y ont jamais adhéré ; les Démocrates sont ceux qui la soutiennent.
Une première chose à noter c’est ce que ces deux catégories n’existent qu’au sein de ceux qu’on pourrait appeler « le public politique », c’est-à-dire la couche assez mince de citoyens qui s’intéressent de façon active et soutenue à la vie politique au point d’avoir des idées et des attitudes bien définies, qui les distinguent de cette population générale que le publiciste américain Walter Lippmann a une fois qualifié de bewildered herd, « troupeau ahuri ».
La plupart des membres de cette troupe grégaire suivent le courant impulsé par la partie du public politique qui a le vent en poupe ; mais en même temps, ce sont leurs impressions mal définies et réactions vagues et un peu aveugles qui déterminent le climat général pesant sur ce à quoi les membres du public politique peuvent s’attendre. Dans les systèmes avancés, le public politique est tenu informé de ces mouvements de fond qui se produisent dans la mentalité générale grâce aux sondages et autres études d’opinion produits et publiés avec une grande fréquence – ce qui permet à ses membres d’ajuster ses messages et stratégies. En Afrique, le public politique doit s’en tenir à la méthode du doigt mouillé et est assez souvent pris de court.
Et pourtant l’enjeu est, en l’occurrence, de taille, du fait des différences de portée existentielle existant entre démocratie et autoritarisme.
La démocratie est un régime moral, l’autoritarisme, un régime moralisateur. La première repose sur des vertus politiques, le second sur des prescriptions dépolitisatrices. Cela rend la méthode de la première à la fois plus ardue et plus digne, et celle du second plus simple mais aussi plus infâme. La complexité de la démocratie joue contre elle, en particulier parce qu’elle renferme une sorte de contradiction entre ses fondements moraux et les implications pratiques de son organisation institutionnelle.
La méthode démocratique était chose nouvelle en Afrique, puisque depuis l’indépendance, la plupart des pays n’ont connu qu’une diversité de méthodes autoritaires de gouvernement. Ceux qui se sont engagés dans la vie politique suivant les règles du jeu démocratique au début des années 1990 ont, pour la plupart, été formés par les conditions de l’ère autoritaire. Cela ne veut pas dire qu’ils étaient, de ce fait, ipso facto des autoritaires : au contraire, nombre d’entre eux sont devenus des démocrates radicaux parce qu’ils ont souffert des pratiques autoritaires. Néanmoins, cette longue histoire d’autoritarisme n’a pas entraîné le public politique – et encore moins le public général – aux procédés de la méthode démocratique, et surtout à son moteur central, le débat. (Alors même que le sens du débat était pourtant au cœur de la formation politique foncière de l’ancienne Afrique, la petite communauté politique à régime municipal). Le débat n’implique pas l’harmonie : au contraire, il n’existe que parce qu’il y a, dans la société, une disharmonie naturelle des intérêts et des passions – qu’il s’agit cependant de gouverner avec le minimum de tort aux sociétaires et donc le maximum d’engagement de leur part.
Une telle entreprise requiert de la part de ceux qui y sont engagés les vertus démocratiques que sont la tolérance, l’humilité et l’introspection, bref, des formes de douceur morale qui sont nécessaires lorsqu’il faut ajuster entre elles tant de tendances différentes et adverses et parvenir ainsi à vivre ensemble avec le minimum de frictions. Or la superstructure institutionnelle du régime démocratique provient d’une histoire très particulière – anglo-franco-américaine – qui ajoute au débat la compétition pour départager les débateurs sur le mode de la victoire et de la défaite. Sans surprise, le débat se transforme, à ce niveau, en compétition, voire en une pure course à l’échalote, toutes choses qui requièrent les qualités exactement à l’opposé des vertus démocratiques. Pour gagner, en effet, il vaut mieux ne pas être trop tolérant ; une certaine dose d’arrogance paraît nécessaire ; et il convient de ne pas trop fouiller dans ses sentiments et convictions intimes. Et bien entendu, il y a infiniment peu de chance qu’on puisse garder les mains propres en toutes circonstances.
Ajoutez à cette contradiction le fait que, contrairement aux systèmes autoritaires où règne le principe du secret du prince – même si vous découvrez ledit secret, il vaut mieux pour vous de ne pas en parler – tout ou presque est exposé à la vue des citoyens, au nom de la transparence et de la liberté de la presse, ingrédients institutionnels du régime démocratique. Il s’ensuit de ce fait qu’alors même que la démocratie est le régime de la dignité – c’est-à-dire celui où les citoyens, pétris de droits, attendent de leurs dirigeants qu’ils soient respectables, voire exemplaires – il est aussi celui qui inspire le plus de mépris à l’endroit des dirigeants, puisque ces derniers ne peuvent guère dissimuler des turpitudes à l’endroit desquelles les citoyens sont plus sensibles que sous un autre type de régime.
Il est possible d’être un leader politique à succès, et pour des raisons que les citoyens pourraient avoir raison de respecter, malgré toutes les chausse-trappes et champs de mine de ce système : mais cela requiert une personnalité d’une certaine qualité – une personnalité d’idéaliste – qui aura du mal à prendre forme et à prospérer dans une société politique où l’appareil d’État est faible (et donc peu protecteur) et la tradition autoritaire a un ancrage plus ancien. (S’agissant du fait que l’appareil d’État est peu protecteur et la tradition autoritaire est très enracinée : prenez seulement en compte le fait que les médias publics, qui en font partie, deviennent, dans la plupart des pays, la propriété exclusive de la faction qui arrive au pouvoir en dépit des règlementations censées garantir l’équité d’accès, ce qui est un legs de l’époque autoritaire qui faisait de l’appareil d’État un appendice du parti au pouvoir – on parlait de parti-État – ou, le cas échéant, de la junte en place).
Étant donné tous ces détails, il peut même paraître étonnant que la méthode démocratique ait autant « pris » en Afrique. En dehors du monde occidental et de l’Amérique latine, l’Afrique subsaharienne est la région qui s’y est le plus essayé, et qui, alors même qu’elle échoue à la mettre en œuvre de façon optimale, persiste à en faire la norme d’organisation politique vers laquelle – selon ses organisations et engagements internationaux – elle devrait tendre. En novembre 2000, le président malien Alpha Oumar Konaré fit adopter une « Déclaration de Bamako » appelant à rendre la démocratie indissociable de la Francophonie, avec le soutien pour ainsi dire réflexe des pays sub-sahariens. Les réserves vinrent du Vietnam et du Laos qui firent savoir qu’ils n’avaient rien contre la démocratie, pourvu qu’elle n’inclue pas… le multipartisme. (Un article de la Déclaration avait posé que la démocratie allait de pair avec le multipartisme et que l’opposition devait avoir un statut clairement défini, exclusif de tout ostracisme).
Néanmoins, entre les complexités et contradictions du régime démocratique et les instincts politiques autoritaires hérités du passé, la méthode démocratique a fini par décevoir ou désappointer le sentiment public dans la plupart des pays africains où elle était appliquée, alors même qu’y aspiraient passionnément les populations des pays sous férule autoritaire. Dans les pays où prévalait la méthode démocratique, un désir confus et quelque peu naïf d’un système plus simple, propre et efficient s’est fait jour dans la population générale.
Ce genre de désir n’est d’ailleurs pas uniquement africain, on le retrouve dans les pays occidentaux où l’on parle, à son sujet, de populisme. Ces désirs rejettent les élites, en particulier la classe politique, perçue comme facteur essentiel de mauvaise gouvernance – aux États-Unis, il est question, à son sujet, de swamp, « marécage » – et se fixent sur un bouc émissaire, l’immigration en Occident, l’impérialisme en Afrique. Dans un cas comme dans l’autre, le bouc émissaire est identitaire : c’est l’immigration du Sud qui est décrite comme une « invasion » dans le narratif nativiste occidental ; c’est la relation avec l’Occident qui est dépeinte comme une « occupation » dans le narratif anti-impérialiste africain. (À cause du caractère particulier du narratif occidental en question, j’ai toujours trouvé douteux la tendance du commentariat français à vouloir mettre dos à dos populisme de droite et un prétendu populisme de gauche – lire, Jean-Luc Mélenchon et LFI. Peut-être Mélenchon voudrait-il en effet être populiste : mais dans le climat actuel, il ne le peut pas).
Ce changement du climat politique favorise la faction des Autoritaires. Ces derniers, comme je l’ai indiqué plus haut, relèvent d’une vision politique moralisatrice plutôt que morale qui simplifie les problèmes politiques à travers des prescriptions dépolitisatrices. L’attitude morale repose sur la difficile culture de vertus politiques et non sur la certitude de détenir la vérité morale qu’il suffirait dès lors d’imposer à tout le monde à travers des prescriptions qui interdisent le débat politique, c’est-à-dire le cœur de l’activité civique en climat démocratique.
Pour les Autoritaires, il existe une doctrine « morale » (de fait, idéologique) qui est animée non pas par des vertus à acquérir et cultiver, mais par des règles à appliquer et à suivre. En lieu et place d’un débat, on se retrouve avec un discours unique et unanimiste ; et au lieu de débateurs, on est dans une situation où les détenteurs autoproclamés de la seule vérité font face à ceux qu’ils voient comme des traîtres ou en tout cas des obstacles qu’il s’agit de combattre (non de débattre) et de proscrire (non de persuader). La situation est donc simplifiée, en effet, puisqu’il n’y a plus de politique – et le dirigeant idéal pour de telles aspirations est bien le chef militaire, puisque la Caserne est le lieu, à l’opposé de la Cité, où il n’y a que commandement et obéissance et un respect aveugle de la hiérarchie qui peut appliquer la loi martiale – point la loi civile – à tout manquement et à toute dissidence.
On peut dès lors comprendre les applaudissements qui ont accueilli la tentative de Pascal Tigri à Cotonou au sein de ce qui est l’équivalent africain de ce que les Français appellent la fachosphère. L’exultation et l’euphorie étaient telles que nombre ceux qui en font partie refusèrent de croire en l’échec de l’entreprise. Parmi les commentateurs de la vidéo YouTube de la retransmission du message de Patrice Talon annonçant la survie de son régime et du gouvernement civil au Bénin, nombreux furent ceux qui s’évertuèrent à démontrer qu’il s’agissait d’un montage IA afin de nier encore quelques heures de plus une réalité déprimante. Aussi étrange que cela puisse paraître, il s’agissait souvent de non-béninois (il y avait quelques Anglophones), qui n’avaient donc pas de mise personnelle dans cette histoire – ce qui souligne l’intensité de la ferveur autoritaire sur le continent.
De l’autre côté, les Démocrates ont eu du mal à défendre Patrice Talon parce que sa gestion du pouvoir leur apparaît comme étant en porte à faux avec les principes d’un régime démocratique orthodoxe. Le dilemme qui se pose à eux est qu’alors que les Autoritaires défendent leur cause avec une virulence passionnée, ils voudraient, quant à eux, plutôt s’atteler à la tâche plus laborieuse et apparemment peu exaltante d’améliorer et de réformer la méthode démocratique dans les pays. Cette tâche leur impose de prendre à partie les dirigeants civils qui font souvent partie du problème à résoudre à cet égard. Si elle a des aspects exaltants, ces derniers ne sont guère mis en exergue, pour des raisons qu’il serait intéressant de mettre au clair.
Quoiqu’il en soit, une telle tâche aurait pu s’accomplir à sa façon quelque peu léthargique – plus de paroles que d’actes, plus de routine mimétique que d’innovations adaptées aux problèmes africains – sans trop de danger si le climat de l’opinion générale n’était devenu si favorable aux Autoritaires. Or, par des effets de malentendu qui n’ont rien de surprenant dans un tel climat, la critique à visées réformatrices des Démocrates (style, « ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain ») peut être confondue avec la critique radicale (le bébé mérite autant le caniveau que l’eau de son bain) des Autoritaires. Ils deviennent ainsi les alliés objectifs de leurs adversaires idéologiques et renforcent, par l’expression généralement plus outragée que constructive de leurs frustrations, le climat antidémocratique qui imprègne les opinions générales sur le continent – en tout cas, dans les pays qui essaient de pratiquer la démocratie. (Ceci mérite d’être noté : les plus ferventes félicitations adressées au Bénin pour son échappée belle que j’aie lues dans la presse africaine provenaient de… Bamako).
D’ailleurs les Démocrates méritent un peu la critique que j’ai adressée plus haut aux politiciens du Sahel (et du Bénin) : ils manquent de militantisme et ne s’organisent pas pour influencer les masses. Ils semblent avoir, comme disent les économistes, concédé le marché. Il se peut qu’il leur faille traverser encore plus d’évènements malheureux pour davantage secouer leurs esprits – et à cet égard, je gagerais qu’il n’y a pas de Démocrates plus sincères aujourd’hui en Afrique de l’Ouest que ceux qui adhèrent à cette méthode politique au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Comme dit le grec, pathemata mathemata, « mes souffrances sont mes leçons ».
Rahman Idrissa
NB: Le titre et le chapeau sont de la Rédaction