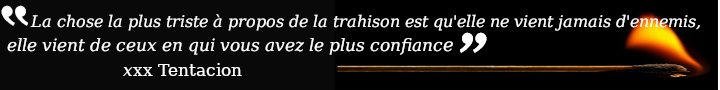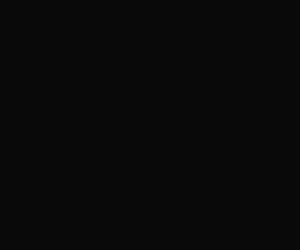Par Rahmane Idrissa
En octobre dernier, j’ai publié un essai pour le numéro inaugural de Equator, magazine en ligne mis sur pied à Londres par l’essayiste et romancier Pankaj Mishra et la journaliste Nesrine Malik. L’essai s’intitule “Statemania” et est une exploration à la fois personnelle et analytique de la fin de l’hégémonie américaine. Pour ceux qui lisent l’anglais, il est disponible ici (il est accessible gratuitement mais il faut d’abord s’inscrire à la Newsletter du magazine). J’en ai traduit la fin, à cause de l’éclairage qu’elle jette sur l’Affaire Venezuela en cours. L’allusion au Niger, au début de l’extrait, fait suite à un passage antérieur où j’avais filé une comparaison assez provocante (sans doute) de la situation au Niger et aux USA.
Le nationalisme recherche la liberté de dominer, et non les intrications de l’hégémonie. Les États-Unis et le Niger faisaient partie de ces intrications, aux extrémités opposées du système. Tous deux veulent en sortir, et si les timides efforts du Niger pour s’en extraire passent presque inaperçus – même si les nationalistes nigériens pensent que les capitales occidentales, en particulier Paris, scrutent chacun de leurs mouvements –, le démantèlement brutal du même système par les États-Unis ne peut être ignoré, compte tenu de ses conséquences cataclysmiques.
L’hégémonie diffère de la simple domination en ce qu’elle implique les aspirations des « hégémonisés ». Les États-Unis ont réussi à susciter un unisson de ces aspirations à la fin de la guerre froide, lorsque même les puissances qui les avaient autrefois défiés ont soudainement commencé à les admirer. Il y a quelques années, un professeur chinois dont j’étais le conférencier invité m’a fait visiter les universités de Pékin. Il m’a expliqué que ces établissements avaient d’abord été calqués sur le modèle des universités soviétiques, puis remaniés dans les années 1990 pour devenir des répliques des universités américaines. Avec la nostalgie d’un « Statemaniaque » (nous sommes de la même génération), il m’a dit que la Chine voulait à ce moment-là devenir comme les États-Unis. Au cours de la même décennie, la Russie a adopté la thérapie de choc de Washington, dans l’espoir de se transformer en Amérique de l’Eurasie. Il y avait un appel à l’hégémonie mondiale, et les États-Unis étaient en mesure d’y répondre, ayant œuvré dans ce sens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les États-Unis ont commencé à partir de ce moment à régenter le vaste réseau d’institutions et d’organisations mondiales que les spécialistes des relations internationales ont pompeusement baptisé « l’ordre mondial fondé sur des règles et dirigé par les États-Unis ». Il s’agissait d’un pacte. La puissance hégémonique menait la danse, ce qui était considéré comme un service rendu ; en échange, elle pouvait enfreindre les règles en toute impunité, de concert avec un appendice – Israël – avec lequel elle partageait ce privilège singulier. Le pivot du pacte était qu’aucun autre souverain ne pouvait chercher à égaler son pouvoir de dissuasion ou son niveau de contrôle économique.
C’était là le roc sur lequel s’était établie l’hégémonie ambiante – et les autres devaient investir dans le pouvoir de l’hégémon, et non le contester. La promotion des droits de l’Homme fournissait une superstructure éthique, et la promesse d’une vie meilleure, la référence universelle : c’était là, selon Fukuyama, ce qui constituait la fin de l’histoire. Mais dans l’une de ces ruses de l’histoire dont parlait son maître, Hegel, cette étape suprême dans l’ascension de l’Amérique s’est également avérée être un sommet à partir duquel une nation ne pouvait que décliner.
Il s’est avéré que le roc était en réalité du sable mouvant. Au début des années 2000, les anciens challengers, notamment la Chine, ont fait leur retour sur le devant de la scène, refusant d’adopter l’humble attitude d’investisseurs dans la puissance hégémonique que les Européens et les États du Golfe avaient adoptée. Le pacte s’effritait également au plan domestique.
L’hégémonie avait mondialisé les opportunités, y compris, involontairement, pour les plus défavorisés du monde, qui refusaient d’être exclus de la quête d’une vie meilleure. Dans la plupart des pays riches, y compris les États-Unis, leurs migrations ont été accueillies avec un mélange d’indignation et d’exploitation. Pour les xénophobes d’extrême droite en plein essor aux États-Unis et en Europe, les conséquences involontaires de l’hégémonie ont alimenté la politique tribale dont ils avaient besoin pour se frayer un chemin vers le pouvoir : les idéologies du « nous contre eux » nécessaires pour s’opposer à ceux qu’ils dénonçaient comme des « mondialistes ».
En Amérique, la Chine et les Mexicains sont devenus les deux pôles de la politique, le premier obsédant les élites, les seconds la population générale. Le tribalisme, notre plus ancienne idée politique, a regagné du terrain et a suscité des « solutions finales », même si les enchevêtrements tissés par l’hégémonie rendaient cette aspiration irréaliste.
Par conséquent, même si la fin de l’hégémonie américaine semblait inévitable, on s’attendait à ce qu’elle se fasse lentement, en un effondrement de longue durée qui laisserait le temps de s’adapter. Le tribalisme et ses instincts irréfléchis seraient maîtrisés. Avec le Partenariat transpacifique, Obama avait l’intention de mettre en place une coalition hégémonique conventionnelle contre la Chine, préservant ainsi l’image d’un leadership américain respectueux des règles, tandis que le tourbillon des mouvements de justice sociale qualifiés de « woke » dans les années 2010 semblait capable de contenir le nationalisme blanc américain – jusqu’à ce que Trump émerge comme le leader des tribaux.
Trump a accéléré la sortie des États-Unis, affirmant que cela rendrait l’Amérique « grande » (dominante) à nouveau, et ce faisant, il a brisé les garde-fous du constitutionnalisme chez lui et de l’hégémonie à l’étranger. Sous sa direction, la nation qui se présentait autrefois comme la cité phare au sommet de la colline se transforme rapidement, sous nos yeux, en la tour sombre de Sauron, déterminée à appauvrir ses voisins, à entretenir le génocide et à ressusciter les trolls du passé néfaste du pays.
La fin de l’hégémonie offre de nombreuses opportunités, mais elle se déroule actuellement de la pire manière possible. Les États-Unis puisent dans les ressources d’une puissance hégémonique – rendant compte à ses dépendants – pour revendiquer la liberté d’une puissance dominante, qui n’a de comptes à rendre à personne. Il n’y aura peut-être pas de retour en arrière possible, même si les électeurs expulsent demain les tribalistes du pouvoir.
Il est désormais courant pour les historiens de parler du « court » XXe siècle : celui qui a commencé avec la Première Guerre mondiale, balayant ce qui restait du « long » XIXe siècle, et se concluant de façon abrupte avec la chute du bloc soviétique. Selon ce récit, les illusions totalitaires, celles du fascisme et du communisme, ont été rejetées par la bonne et vraie affaire, le libéralisme – un libéralisme revêtu des couleurs de l’Amérique. C’est à ce moment-là, à l’apogée de la « statemania », que le XXIe siècle a commencé ; ou, selon certains, que l’histoire elle-même a pris fin.
Mais aujourd’hui, peut-être, une autre histoire peut être racontée. Peut-être que le XXe siècle a tranquillement perduré pendant encore quelques décennies, jusqu’à ce que Trump revienne à la Maison Blanche. Au jour de la « libération » – comme le concluront peut-être les historiens du futur –, l’hégémon lui-même a dissipé l’aura mystique qui enveloppait ses actions, voire ses transgressions, et a rompu le charme. Il s’avère que le libéralisme américain était la dernière illusion.
Rahmane Idrissa
janv. 04, 2026