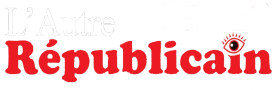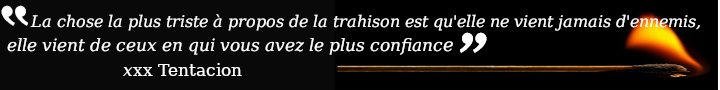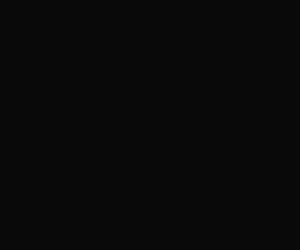Le débat sur les bienfaits de l’aide publique au développement n’est pas nouveau. Cependant, les récents bouleversements politiques dans les pays de l’AES, le retrait de plusieurs bailleurs après les changements des régimes au Sahel (notamment au Niger), ou encore le retour de Donald Trump au pouvoir avec la suppression de l’USAID ainsi que le basculement vers une logique de business relancent ce débat avec une acuité particulière.
Déjà en 1984, à la tribune de l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Président Thomas Sankara interrogerait et dénonçait la dépendance créée par l’assistance en ces termes :« Nous encourageons l’aide qui nous aide à nous passer de l’aide. Mais en général, la politique d’assistance et d’aide n’aboutit qu’à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. »
Après plusieurs décennies d’aide publique au développement, les résultats restent globalement décevants. À l’image des politiques menées, la pauvreté et la vulnérabilité demeurent persistantes, les inégalités restent endémiques et les États souffrent d’une fragilité structurelle préoccupante. L’absence de vision claire en matière de développement, le désengagement progressif des pouvoirs publics des secteurs sociaux de base au profit des ONG, ainsi que la multiplicité d’acteurs opérant sans réelle coordination, ont contribué à installer un système à la fois désordonné et dépendant.
En réalité, les interventions humanitaires auraient dû compléter l’action de l’État, et non s’y substituer. Elles auraient pu constituer un levier majeur pour un véritable bond en avant sur le chemin du développement. Or, nous nous retrouvons aujourd’hui avec l’un des indices de développement humain les plus bas au monde, accompagnés de critiques, parfois justifiées, parfois excessives sur les bienfaits de cette solidarité internationale, qui s’apparente de plus en plus à une épée de Damoclès pour les pays en développement.
Il existe, sans nul doute, une responsabilité partagée dans cet échec ; celle des partenaires internationaux, mais aussi celle de nos propres décideurs politiques. Toutefois, il serait injuste d’occulter l’impact positif et le travail remarquable que continuent de réaliser les acteurs humanitaires, qu’il s’agisse de répondre aux urgences ou d’accompagner certains processus de développement. Reste qu’il est nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, de questionner l’opportunité, l’efficacité et les méthodes de certaines interventions, afin de repenser leur contribution au développement local.
L’économie humanitaire, une dépendance institutionnalisée
Dans ce texte, l’économie humanitaire ou de l’assistance, fait référence à une économie dans laquelle l’aide publique au développement occupe une place déterminante dans la performance économique nationale. Au Niger, comme dans de nombreux pays en développement, ce secteur est devenu l’un des principaux moteurs d’emploi et d’investissements. Quelques faits et chiffres qui illustrent cette réalité :
Quelques faits et chiffres qui illustrent cette réalité :
En 2024, selon le ministère de l’intérieur, le secteur humanitaire a investi plus de 250 milliards de FCFA, créé 26 872 emplois (dont 34 % permanents), et généré 17 milliards de recettes fiscales.
Les 250 milliards mobilisés par le secteur humanitaire correspondent 14,3 % de l’exécution du budget général du Niger pour l’année 2024 (1 749,92 milliards hors exonérations). Ce montant est également supérieur aux recettes fiscales provenant du secteur pétrolier, qui s’élèvent à 153,6 milliards de FCFA [1].
Les 17 milliards de recettes fiscales issues des ONG dépassent à elles seules quatre fois les recettes fiscales de la région de Diffa en 2024 [2].
Les dons projets représentent près de 26 % des investissements exécutés en 2024, cumulé aux emprunts projets cela représente environ 46% des investissements.
Les 9151 emplois permanents créés par les ONG équivalent à 15 % des effectifs de la fonction publique (61 336 agents en 2024) [3].
Ces chiffres démontrent le poids considérable du secteur humanitaire dans l’économie nationale. Malheureusement, cette dynamique repose sur une dépendance fragile soumise à plusieurs aléas qui ne répondent plus, ni aux enjeux ni aux orientations actuelles de nos pays et de la géopolitique internationale de l’aide au développement. D’ailleurs, certains bailleurs utilisent cette aide comme une arme diplomatique. D’où la nécessité et l’urgence de sortir intelligemment de ce cercle vicieux, tout en consolidant les acquis.
Passer à l’ Economie Sociale et Solidaire (ESS)
La vision pour un développement endogène, la refondation de l’État, l’affirmation de la démarche de souveraineté exigent un changement de modèle, une réflexion sur l’avenir en commun. Il faut sortir de manière intelligente de cette économie d’assistance, inadaptée aux enjeux actuels, afin de bâtir une économie endogène, responsable et solidaire, et surtout ne pas tomber dans un système libéral.
Cette alternative existe. Il s’agit de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS.. C’est une économie qui cherche à concilier activité économique et utilité sociale. Elle repose sur des principes de solidarité, de coopération, de démocratie et de primauté de l’humain sur le profit.
L’ESS est une voie crédible et adaptée à nos réalités car :
Elle place l’humain et la solidarité au cœur de l’activité économique.
Elle valorise les initiatives locales comme les coopératives, les mutuelles et les PME sociales.
Elle favorise l’emploi des jeunes et des femmes dans des secteurs productifs et durables.
Elle répond aux urgences climatiques et sécuritaires, grâce à des approches endogènes et résilientes.
[1]. www.cadhp-niger.ne/index.php/rapport-d-execution/category/161-rapport-2024
[2]. https://www.anp.ne/mobilisation-des-recettes-fiscales-la-dri-de-diffa-depasse-ses-objectifs-de-2024-avec-plus- de-35-milliards-de-fcfa-de-recettes-realisees-responsable
[3]. https://www.anp.ne/la-fonction-publique-nigerienne-compte-61366-agents-dont-37322-masculins-24044- feminins-et-35825-agents-a-statut-particulier/
Une ingénierie pour la transformation de notre modèle économique
Opérer cette transformation ne se fera pas en un jour et surtout de manière non coordonnée et abrupte, au contraire elle nécessitera une vision stratégique globale et partagée, portée au premier rang par les décideurs politiques.
Quelques pistes concrètes pour amorcer cette transition vers un modèle plus durable et responsable.
Faire de l’Économie sociale et solidaire (ESS) le modèle de développement national : mettre en place un cadre réglementaire clair, une politique nationale de l’ESS et un écosystème incitatif favorisant son expansion. L’exemple du Sénégal, qui dispose d’un ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ainsi que d’un conseil interministériel sur l’ESS, constitue une source d’inspiration. Une telle architecture, adaptée à nos réalités, gagnerait en efficacité si le conseil interministériel relevait directement de la Présidence de la République, gage d’un engagement politique fort et durable.
Mobiliser l’expertise et créer une Agence nationale de développement : cette institution aurait pour mission de coordonner le secteur humanitaire, de suivre et d’évaluer les projets, de pérenniser les acquis et surtout de piloter la transition vers une véritable économie sociale et solidaire. Elle devra s’appuyer sur des expertises solides, des compétences techniques locales et un agenda clair, garantissant cohérence et efficacité. Son action viendra renforcer le rôle du ministère de tutelle, chargé de conduire les réformes structurelles nécessaires.
Mutualiser les efforts et planifier la transition : l’État doit pleinement assumer son rôle stratégique en garantissant l’efficacité et l’efficience de l’aide, via l’Agence nationale de développement et le ministère concerné. Dans le même temps, il devra améliorer sa capacité de mobilisation des ressources extérieures à moyen terme, afin de laisser à l’ESS le temps de s’enraciner et de produire ses effets. Cette transition doit être accompagnée de réformes complémentaires, notamment dans le secteur privé et l’industrialisation, pour poser les bases d’une stratégie de développement globale et cohérente sur 10 à 20 ans.
ALLAHI BIZO Ismaël
Directeur de Makera Institute et de la Fabrique ESS