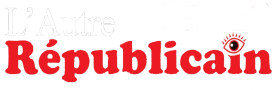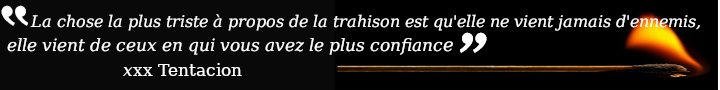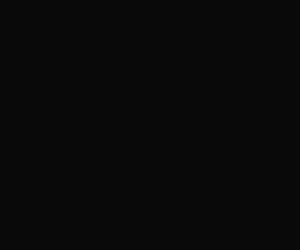Reléguée aux marges du paysage politique transitoire, depuis quelques temps, la Dynamique Citoyenne pour une Transition Réussie (DCTR) refait surface. Dans une déclaration rendue publique, samedi 12 juillet 2025, au Centre Culturel Oumarou Ganda (CCOG) de Niamey, son Comité d’orientation passe en revue la situation nationale, régionale et internationale. Dans cette déclaration aux relents d’un combat d’arrière garde, la DCTR a réaffirmé son soutien au CNSP et appelé à une gouvernance plus inclusive. Mais derrière ces mots diplomatiques, se dessine une question brûlante : pourquoi maintenant ? Et surtout, pour quoi faire ?
Il faut rappeler que la DCTR, dans son essence, est née d’une volonté d’occuper un espace politique devenu orphelin des partis traditionnels, suspendus dès les premières heures de la prise du pouvoir par le CNSP. Sur un échiquier dominé alors par les « laboussanistes », ces partisans inconditionnels des putschistes, la DCTR se voulait un contrepoids modéré, patriote mais critique, capable d’orienter la transition vers un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Mais très vite, elle est éclipsée, marginalisée, voire soupçonnée d’entretenir une proximité avec l’ancien président Issoufou Mahamadou, un héritage politique devenu gênant pour les tenants d’un changement de système.
La grande oubliée des Assises nationales, absente du Conseil Consultatif de la Refondation (CCR), la DCTR a vu son espace d’influence se réduire comme peau de chagrin. Ce silence prolongé avait fini par entériner son effacement. Sa déclaration du 12 juillet dernier apparaît donc comme une tentative de résurrection. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi choisir ce moment précis, alors que la transition semble amorcer un nouveau virage institutionnel et que les rapports de force sont déjà figés ?
Dans sa déclaration, la DCTR se félicite des avancées de la transition, réaffirme son attachement au CNSP, et s’inscrit dans une ligne de soutien modéré. Elle félicite aussi et encourage les Forces de Défense et de Sécurité, loue les efforts de relance économique, encourage le dialogue social. Le ton est équilibré, consensuel, presque technocratique. Mais à y regarder de plus près, certaines formules en disent long sur les frustrations contenues. En effet, elle salue la mise en place du CCR mais n’oublie pas de pointer du doigt, en creux, son exclusion ; elle vante la nécessité d’un dialogue inclusif tout en soulignant la « persistance d’un climat social fragile ». On est donc loin d’une simple déclaration de fidélité. C’est un message codé, adressé aux sphères du pouvoir, mais aussi à l’opinion.
La DCTR pose une série de constats justes et légitimes. Elle s’inquiète de la dégradation sécuritaire, en particulier dans la région de Tillabéri et dans le Sahel. Elle appelle à une mutualisation des efforts avec les pays du Golfe de Guinée. Sur le plan social, elle souligne l’impact de la cherté de la vie, l’oisiveté d’une jeunesse désorientée, les tensions identitaires. Elle recommande un accompagnement renforcé aux producteurs agricoles, une diplomatie dynamique, une intégration régionale plus solidaire. Le ton est sérieux. Et pourtant, quelque chose sonne comme un appel désespéré à retrouver une place dans le débat public.
Car si la DCTR se revendique d’un patriotisme républicain, elle reste aujourd’hui en dehors de tous les cercles de décision. Son absence prolongée n’a laissé qu’un vide que d’autres acteurs, plus engagés aux côtés du CNSP, ont su occuper avec force. Les « laboussanistes », devenus pour la plupart membres du CCR, tiennent les rênes de l’orientation politique de la transition. Et la DCTR, reléguée au rôle d’observateur, tente désormais de reconquérir un terrain miné.
Faut-il y voir un calcul politique ? Très probablement. La transition approche, lentement mais sûrement, d’un tournant décisif. L’idée d’un retour à la légalité constitutionnelle, fut-elle repoussée, oblige déjà certains acteurs à se positionner. Et pour la DCTR, dont les racines idéologiques sont moins tranchées, moins populistes, que celles des autres forces en présence, c’est peut-être le dernier wagon à prendre avant de sombrer définitivement dans l’oubli.
Mais la manœuvre suffira-t-elle ? Car au-delà des discours et des appels à l’unité nationale, c’est la crédibilité de cette structure qui est en jeu. Peut-elle encore mobiliser ? Peut-elle convaincre une population lassée par les slogans creux et les récupérations politiques ? Peut-elle peser, même symboliquement, dans un environnement politique figé, verrouillé et de plus en plus polarisé ?
En somme, la DCTR tente un retour. Un retour masqué par une déclaration lissée, mais qui laisse transparaître une urgence : celle de ne pas laisser le champ libre à ceux qui ont su manœuvrer mieux, plus vite, plus habilement. L’avenir nous dira si cette tentative relèvera du sursaut ou du chant du cygne. Une chose est certaine : dans un Niger en recomposition politique lente mais profonde, le silence est une mort certaine. Et la DCTR semble l’avoir compris… peut-être un peu tard.
Mahamadou Tahirou