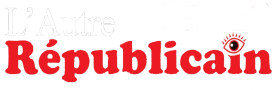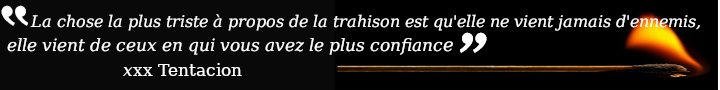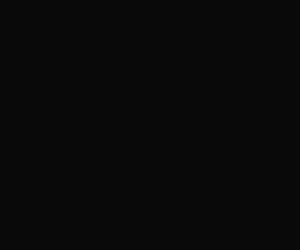Les faits sont graves. Ils dépassent le simple cadre d’un conflit administratif pour toucher au cœur même d’un droit fondamental : la liberté syndicale. Depuis quelques mois, le Niger semble engagé dans une inquiétante spirale de répression contre les organisations de travailleurs. Ce qui, hier, paraissait exceptionnel devient aujourd’hui une habitude : dissoudre des syndicats comme on rature un mot sur une feuille, sans débat, sans procès, et surtout, sans égard pour les obligations internationales du pays.
Au départ, certains ont voulu relativiser. Les premières victimes furent des syndicats d’agents de la douane et des eaux et forêts. Le gouvernement avait alors trouvé un argument jugé recevable par une partie de l’opinion. Ces travailleurs étaient des agents en uniforme, soumis à un principe strict de discipline militaire. Ce qui a été matérialisé dans l’article 39 de la charte de la refondation qui dispose que : « Nonobstant les dispositions de l’article 38 , l’exercice du droit syndical est formellement interdit à toutes les Forces de défense ct de sécurité. »
Même si cette justification pouvait se discuter à l’aune des conventions n°87 et n°98 de l’OIT toutes deux ratifiées par le Niger, elle avait au moins la cohérence d’un raisonnement fondé sur le statut particulier des Forces de défense et de sécurité.
Mais la suite a balayé toute illusion. Le 7 août 2025, le couperet est tombé sur le Syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN), le Syndicat national des agents de la justice (SNAJ) et le syndicat des cadres et agents de la justice (SYNCAT). Aucun uniforme ici. Aucun lien avec une hiérarchie militaire. Ces syndicats regroupent exclusivement des fonctionnaires civils du secteur judiciaire. Et pourtant, eux aussi ont été dissous, sans autre forme de procès. Cette fois, l’argumentaire sécuritaire ne tient plus. Car l’article 38 de la charte de refondation dispose que : « l’État reconnaît et garantit le droit syndical qui s’exerce dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur ce droit syndical s’impose à toute entreprise ou groupement d’entreprises exerçant sur le territoire national ». Alors, quelle justification restera-t-il à brandir ?
Or, la réponse se trouve déjà dans les textes que le Niger a librement ratifiés. La Convention n°87 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en son article 2, est claire : « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’y affilier. » Et l’article 4 précise que la dissolution ou la suspension d’une organisation syndicale ne peut intervenir que par voie judiciaire et dans des conditions qui garantissent la défense des intéressés. Nulle part, il n’est question d’un pouvoir administratif discrétionnaire permettant à l’exécutif de balayer un syndicat d’un revers de plume.
La question est donc brutale : le gouvernement du Niger a-t-il qualité, au regard de ces engagements internationaux, pour dissoudre un syndicat par simple décision ministérielle ? La réponse est non, sauf à considérer que les conventions ratifiées ne sont que des vitrines diplomatiques dépourvues de force contraignante.
Dès lors, deux interrogations brûlent les lèvres : Le SAMAN, le SYNCAT et le SNAJ vont-ils accepter que leur existence légale soit piétinée sans réagir, au risque d’ouvrir la voie à d’autres dissolutions arbitraires ? Au nom de la solidarité syndicale, les autres centrales même celles auxquelles ces syndicats ne sont pas affiliés auront-elles le courage de se lever pour défendre le principe, au-delà des personnes concernées ?
Car si aujourd’hui ce sont les magistrats et agents de justice, demain ce pourra être n’importe quel syndicat jugé trop critique ou trop indépendant. L’histoire montre que l’indifférence face à une injustice finit toujours par en faire une loi.
Les conventions de l’OIT ne sont pas de simples textes techniques : elles incarnent l’esprit d’un droit universel, forgé pour empêcher précisément ce que nous voyons aujourd’hui. En s’en écartant, le Niger envoie un signal inquiétant, non seulement à ses travailleurs, mais aussi à ses partenaires internationaux, celui d’un pays où la liberté syndicale n’est plus un acquis, mais une faveur révocable à tout moment.
Les prochains jours nous édifieront si les syndicats nigériens choisiront le silence ou la résistance. Mais une chose est certaine : le droit syndical ne se mendie pas, il se défend. Et c’est souvent dans l’épreuve que l’on mesure la valeur réelle des engagements d’un État envers la liberté et la justice.
Mahamadou Tahirou