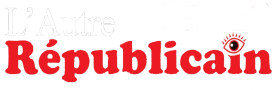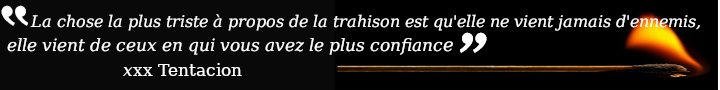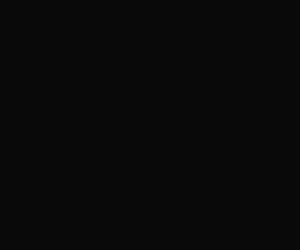Le 26 septembre 2025, le groupe français Orano a publié sur son site officiel cette annonce : « Le tribunal arbitral du CIRDI s’oppose à la vente par l’État du Niger de l’uranium produit par la SOMAÏR ». Cette décision, datée du 23 septembre 2025, confirme une fois encore le verrouillage juridique et diplomatique autour de la ressource stratégique du Niger. Elle marque une nouvelle étape d’un conflit qui, depuis le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, oppose frontalement Niamey au géant français de l’uranium.
Dès sa prise du pouvoir, la junte militaire avait placé la question minière au cœur de sa rhétorique souverainiste. Les autorités nigériennes accusaient Orano d’exploiter les gisements d’Arlit et d’Akokan à vil prix, au détriment du peuple nigérien. La suspension unilatérale de certains accords miniers, les menaces de renégociation et la mise en cause publique de la « dépendance énergétique de la France » à l’uranium nigérien avaient jeté les bases du conflit.
La tension a franchi un cap en 2024 avec la volonté de Niamey de diversifier ses partenaires. Plusieurs annonces spectaculaires ont été faites : accords exploratoires avec la Russie, contacts avec la Chine, discussions avortées avec la Turquie et même des ouvertures vers l’Iran. Pourtant, aucune de ces tentatives n’a abouti à une exportation réelle, bloquées par un enchevêtrement de sanctions, de normes de non-prolifération et de pressions diplomatiques. Des difficultés subsistent :
Première difficulté : la dépendance logistique. L’uranium nigérien ne peut être exporté sans passer par des corridors internationaux (Cotonou, Lomé, Abidjan). Or, depuis la fermeture prolongée des frontières avec le Bénin et les tensions régionales, Niamey se retrouve isolé.
Deuxième contrainte : les normes et accords internationaux. L’uranium est une ressource hautement contrôlée, soumise au Traité de non-prolifération et aux régulations de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Toute tentative de vente « hors système » expose le Niger à des sanctions et à un isolement accru.
Troisième obstacle : l’arsenal juridique. Avec cette nouvelle décision du CIRDI, l’État du Niger est juridiquement empêché de disposer librement de la production de la SOMAÏR évaluée à un peu plus de 1.000 tonnes, au risque de poursuites internationales et de représailles économiques.
En mai 2025, le contentieux entre le Niger et Orano a pris une tournure plus dramatique avec l’arrestation du directeur d’Orano-Niger, M. Ibrahim Courmo, de nationalité nigérienne. Il est détenu malgré une décision de la Cour d’appel de Niamey en faveur de sa libération. Cet épisode, dénoncé par Paris et désormais rappelé dans la décision du CIRDI, a cristallisé l’accusation internationale d’« instrumentalisation de la justice » par le CNSP.
Quelle voie pour Niamey ?
La question se pose avec acuité : comment le Niger peut-il espérer bénéficier de son uranium à l’abri de toute injonction internationale ?
Une première option serait la renationalisation complète et assumée des sites miniers, suivie d’un appel à des partenaires stratégiques « hors Occident ». Mais cette démarche risquerait d’accentuer l’isolement diplomatique et financier du pays.
Une deuxième piste consisterait à engager une stratégie de négociation ferme mais pragmatique avec Orano, en cherchant une meilleure répartition des bénéfices plutôt qu’une rupture brutale. Cela suppose cependant une volonté de compromis que le CNSP peine à afficher.
La décision du CIRDI, en faveur d’Orano, illustre la difficulté pour Niamey de transformer son uranium en véritable levier de souveraineté. Entre les contraintes logistiques, juridiques et géopolitiques, la marge de manœuvre du gouvernement nigérien reste réduite. La souveraineté proclamée du Niger sur son uranium reste donc, pour l’instant, une souveraineté contrariée.
La question n’est plus seulement de savoir comment vendre l’uranium, mais comment redéfinir une stratégie nationale qui conjugue souveraineté, légalité internationale et partenariats réalistes.
Mahamadou Tahirou