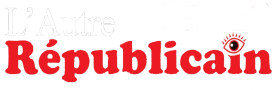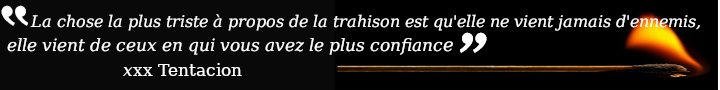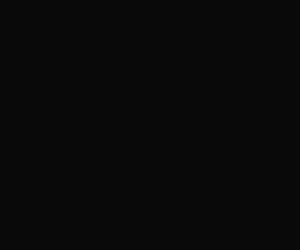Niamey a abrité, le mardi 9 août 2025 à l’hôtel Bravia, un atelier de vulgarisation de la loi sur la cybercriminalité au Niger. L’initiative, portée par l’Association des Professionnelles Africaines de la Communication, Section Niger (APAC-Niger), en partenariat avec Search for Common Ground et avec l’appui des ministères de la Justice et de la Communication, a réuni un public diversifié composé de représentants de la société civile spécialisée dans la veille numérique, de professionnels des médias, de membres des Forces de défense et de sécurité, de magistrats et d’autorités institutionnelles. La cérémonie d’ouverture a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Justice madame Abdourahamane Amina Moussa et l’atelier a été modéré par Ismaël Laoual Salaou, un professionnel des médias chevronné qui a su donner rythme et équilibre aux échanges.
Tout au long de la journée, les participants ont suivi des présentations sur la loi, ses dispositions et ses enjeux, ainsi que sur les défis liés à la cybersécurité au Niger. Les débats qui ont suivi ont été animés et parfois tendus, révélant un malaise sous-jacent : si la loi sur la cybercriminalité, adoptée en 2019, constitue un instrument nécessaire pour protéger les citoyens contre les arnaques, le harcèlement et les fraudes en ligne, elle recèle aussi de nombreuses ambiguïtés qui font craindre des atteintes aux libertés fondamentales, notamment à la liberté de la presse et d’expression.
Les échanges ont rappelé que ce texte a déjà connu deux modifications majeures. La première, intervenue en 2022 grâce au lobbying des organisations de presse, avait permis de supprimer les peines privatives de liberté à l’endroit des journalistes, alignant ainsi la loi sur l’esprit de l’ordonnance 2010-35 qui dépénalise les délits de presse. Mais la deuxième modification, opérée en 2024 à travers l’ordonnance 2024-28, a rétabli et même alourdi ces sanctions, suscitant une inquiétude grandissante parmi les professionnels des médias et les défenseurs des droits humains. Pour beaucoup, cette volte-face illustre la tendance actuelle des autorités à restreindre l’espace démocratique et à museler les voix critiques sous couvert de sécurité numérique.
Dans son allocution, la représentante de l’APAC-Niger Madame Fadimou Moumouni, s’est appesanti sur la nécessité de mieux faire connaître la loi, rappelant que sa pertinence dépend de sa compréhension et de son appropriation par les citoyens. Elle a également souligné que le numérique, bien qu’offrant des opportunités considérables pour l’accès à l’information, la participation citoyenne et le développement, est devenu un terrain fertile pour les arnaques, la désinformation et le harcèlement en ligne. C’est pourquoi l’APAC a voulu créer ce cadre d’échanges, afin que chacun reparte mieux informé et conscient des enjeux.
De son côté, la Directrice pays de Search for Common Ground, Mme Audry Shematsi, a replacé l’atelier dans le cadre du projet régional Laafi-Kibaru, financé par le ministère des Affaires mondiales du Canada et mis en œuvre au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Elle a salué la collaboration entre les institutions publiques et la société civile, tout en appelant à une responsabilité partagée face aux menaces numériques. Elle a défendu l’idée que la loi ne saurait être efficace que si elle est connue et comprise de tous, et si elle est appliquée dans un esprit d’équilibre entre protection et respect des droits. Mais derrière ce discours diplomatique, certains observateurs ont perçu une difficulté à concilier l’appui aux politiques nationales et la défense des libertés dans un contexte politique où l’arbitraire s’installe.
Les interventions des participants ont confirmé ce paradoxe. Des acteurs de la société civile ont dénoncé les risques d’une instrumentalisation de la loi à des fins de répression politique, évoquant des articles formulés de manière vague et donc susceptibles de criminaliser toute critique. Certains magistrats ont reconnu les zones d’ombre du texte, appelant néanmoins à une application « responsable et mesurée », tandis que des représentants des Forces de défense et de sécurité ont souhaité sur la nécessité d’un arsenal juridique ferme pour contrer la fraude numérique et les réseaux criminels transnationaux.
Cet atelier de vulgarisation, au-delà de sa dimension technique, a donc été révélateur d’un malaise plus profond. La cybersécurité est devenue un enjeu crucial, mais elle ne peut être dissociée du climat politique et social. Une loi qui se veut protectrice mais qui fragilise les libertés risque de perdre sa légitimité et de se transformer en instrument de coercition. Pour beaucoup, le véritable défi réside désormais dans la capacité à réconcilier la lutte contre la cybercriminalité avec la consolidation de l’État de droit.
En définitive, la rencontre de Niamey a permis d’ouvrir le débat, même si les divergences restent entières. Elle a rappelé une vérité simple mais souvent occultée, la sécurité numérique ne peut être durable que si elle s’accompagne du respect des libertés fondamentales devaient souligner les participants dans une proposition de recommandation. Au Niger, cette équation demeure à résoudre, et l’avenir dira si la loi sur la cybercriminalité servira à protéger les citoyens ou à contrôler leurs voix.
Mahamadou Tahirou