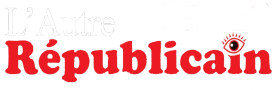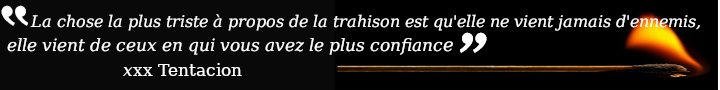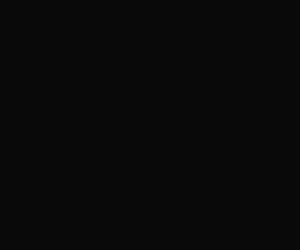Les files d’attente s’allongent à Bamako. Les stations sont vides, les moteurs à l’arrêt, les lampes s’éteignent. Voilà où en est le Mali, après plus d’un mois de blocus jihadiste sur les routes du carburant. Le pouvoir militaire, lui, continue de parler de souveraineté. Mais sur le terrain, le pays suffoque.
Depuis septembre, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, a trouvé une arme plus redoutable que les balles, le carburant. Ils ne cherchent plus seulement à tuer, ils étouffent. En coupant les voies d’approvisionnement depuis le Sénégal et la Côte d’Ivoire, ils privent l’État d’air. Des dizaines de camions-citernes incendiés, des chauffeurs exécutés, des soldats enlevés. Résultat, Bamako, jadis épargnée, est à son tour plongée dans la pénurie, les coupures d’électricité et la colère.
L’électricité rationnée à six heures par jour, les marchés plongés dans le noir, les femmes contraintes de jeter leurs marchandises faute de réfrigération. Le litre d’essence s’arrache à plus de 2000 francs CFA, quand il y en a encore à vendre. Un pays à genoux.
Mais le plus tragique, c’est que cette crise n’est pas seulement sécuritaire. Elle est politique.
Elle révèle la faillite d’un régime enfermé dans un isolement qu’il a lui-même choisi. En rompant avec ses partenaires régionaux et internationaux, le Mali s’est privé de ses voies vitales. Aujourd’hui, Bamako découvre qu’on ne nourrit pas un peuple avec des slogans, ni qu’on fait rouler un État avec des discours martiaux.
Les militaires, qui avaient promis la souveraineté, ont livré le pays à la dépendance la plus brutale, dépendance au marché noir, dépendance au chaos, dépendance à la peur.
Et pendant que les Maliens cherchent de l’essence au compte-gouttes, les officiels répètent « Ce n’est que passager ». Mais rien n’est plus durable que l’improvisation lorsqu’elle devient une méthode de gouvernement.
Cette pénurie, devenue politique, illustre le naufrage d’un modèle, celui d’une souveraineté de façade. Un pouvoir obsédé par la communication, incapable de gouverner dans la réalité.
Car la souveraineté, ce n’est pas s’isoler du monde. C’est la capacité à assurer l’essentiel : l’eau, la lumière, la santé, l’éducation et la dignité.
Or, quand un État ne peut plus garantir à ses citoyens de quoi se déplacer, se soigner ou s’éclairer, il a perdu bien plus que du carburant, il a perdu sa raison d’être.
Cette faillite n’est pas propre au Mali. Elle est le miroir de tout le Sahel. Au Burkina Faso, des régions entières sont assiégées.
Au Niger, la misère s’étend, les écoles ferment, les salaires tardent, les hôpitaux manquent de tout. Partout, la même illusion, celle d’une rupture proclamée, mais jamais construite.
L’Alliance des États du Sahel (AES), née dans la peur d’une intervention extérieure, devait être une alternative.
Elle est devenue un symbole d’impuissance.
Trois pays enclavés, trois économies asphyxiées, trois peuples fatigués. Une alliance sans projet, sans plan, sans perspective. Parce qu’il ne suffit pas de crier « souveraineté » pour être libre. Il faut produire, bâtir, et gouverner avec méthode, pas avec des discours.
Aujourd’hui, le Mali étouffe faute d’essence, mais en réalité, c’est tout un modèle politique qui est en panne. Les slogans n’éclairent pas les rues. Les discours ne remplissent pas les réservoirs.
Et la souveraineté proclamée ne vaut rien si elle ne permet pas à un peuple de vivre dignement.
Les régimes militaires ont promis la renaissance, ils ont livré la pénurie. Ils ont juré la dignité, ils ont installé la dépendance.
Ils ont clamé l’unité, ils ont semé la peur et la division.
Ce drame malien est un signal pour tous. Il dit une chose simple, les incantations ne construisent pas les États, elles les détruisent.
Et si nous ne nous réveillons pas maintenant, c’est tout le Sahel qui sombrera dans le silence des pompes vides et l’obscurité des illusions perdues.
Waziri Idrissa