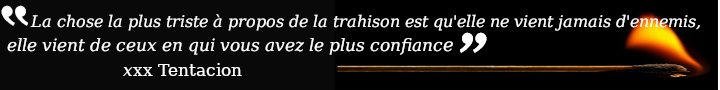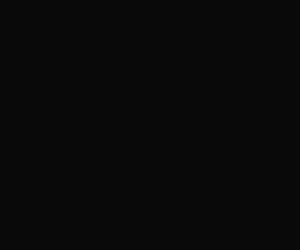Nous assistons et parfois jouons le rôle d’acteurs chevronnés dans une comédie quotidienne que nous appelons abusivement « histoire ». L’hypocrisie, c’est justement cette interprétation continue de rôles, de scénarios ou d’improvisations, sur la scène de l’éphémère. On programme et, finalement, on produit des bombes, des armes, des missiles, et on recommence à parler d’essais atomiques comme moyen de dissuasion éventuel pour le prochain ennemi. Tout cela pour parvenir à une paix perpétuelle, occasionnelle et évidemment précaire. La paix se transforme en trêve avant de reprendre les armes. L’hypocrisie, c’est-à-dire l’art du jeu, de la fiction ou de la dissimulation, possède divers synonymes qui, sans prétendre à l’exhaustivité, évoquent la fausseté, la duplicité, la simulation ou simplement le mensonge. Ce sont toutes des variations sur le thème qui répondent au sens étymologique du mot d’origine grecque. L’hypocrite était l’acteur qui jouait le rôle que le scénario lui confiait. Il est donc extrêmement difficile de distinguer la fiction de la réalité, car tout ou presque s’est transformé en spectacle de divertissement pour les passagers d’un navire sans destination. La phrase, attribuée au théologien et philosophe danois Soren Kierkegaart, est toujours d’actualité : « Soyez prudents : le navire est désormais entre les mains du cuisinier de bord, et les mots transmis par le mégaphone du commandant ne concernent plus la route à suivre, mais ce que l’on mangera demain ».
La réalité est obstinée, têtue comme le quotidien qui nous oppresse, nous séduit ou simplement nous « arrive ». En elle, ce que nous appelons, souvent sans grande pudeur, la souffrance devient inéluctable. Elle accompagne l’histoire, la vraie, faite de travail, de précarité, d’exploitation, de lutte pour la survie, de menaces, de guerres, d’exils et de déportations. La souffrance d’un monde en perpétuelle gestation et comme surpris lui-même par la cohérence humaine qui la crée. Elle, la souffrance, muette, réduite au silence ou confisquée par l’habitude, trouve souvent dans le cri et surtout dans les larmes le seul moyen de se manifester. Le philosophe et essayiste français Jacques Derrida a écrit à ce sujet : « Au moment même où elles voilent la vue, les larmes dévoileraient ce qui appartient à l’œil. Ce qu’elles font sortir de l’oubli dans lequel le regard les garde en réserve, ce ne serait rien moins que la vérité des yeux dont les larmes révéleraient la destination suprême. Avoir en vue l’imploration plutôt que la vision, diriger la prière, l’amour, la joie, la tristesse plutôt que le regard ». C’est l’indicible souffrance des pères, des mères, des jeunes, des enfants, de ceux qui ne naîtront jamais et la trahison perpétrée en censurant ses causes. Le souvenir de la souffrance creuse des blessures et comme des sillons dans lesquels on peut parfois choisir ce qu’on veut y semer ; la haine, la vengeance ou le début d’un avenir différent pour tous.
Les prophètes sont ceux dont les yeux ont été voilés puis dévoilés par les larmes. Ils ont dans les yeux l’imploration et la prière parce qu’ils sont passés et ont écouté la « grande tribulation ». Souvent persécutés, incompris, trahis, abandonnés, méprisés et souvent ignorés. Les prophètes de notre temps, comme ceux du passé, sont ceux qui parlent et se taisent lorsque c’est le martyre de leurs corps et de leurs paroles qui parle. Ils franchissent les frontières et choisissent de marcher sur les chemins qui ont un cœur. Ils racontent des histoires lointaines et, entre leurs mains, les mots revivent et font croire qu’il existe un autre monde lorsque les larmes seront semées dans les sillons de la vie. Les prophètes écrivent sur le sable, puis confient au vent les mots minuscules et fragiles volés en secret aux rêves des enfants qui jouent dans les rues.
Mauro Armanino