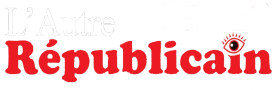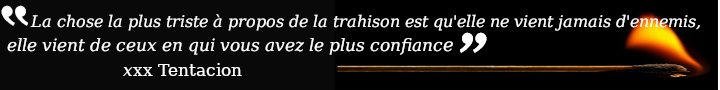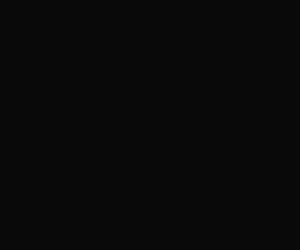Au sens propre, le mirage est un phénomène optique qui se produit, dans des conditions particulières, sur de vastes surfaces planes, et qui permet de voir l’image d’objets éloignés, apparemment reflétés dans une étendue liquide située en bas ou semblant flotter en haut. Au sens figuré, le mirage se présente comme une perspective aussi séduisante que trompeuse, quelque chose d’illusoire, un rêve inaccessible et irréel. Les deux sens du mot mirage sont actualisés dans l’espace fascinant et complexe du Sahel. Les migrants, les commerçants et les contrebandiers transfrontaliers qui traversent, souvent sans retour, les zones désertiques, en font l’expérience au sens propre. On peut apercevoir au loin des sources d’eau, des lacs et des rivières inexistants. Le reste des peuples du Sahel, en revanche, tombe souvent et volontiers dans le sens figuré du terme. Les promesses de sécurité, de bien-être, de justice et de bonne gouvernance se révèlent être des illusions éphémères, soutenues et nourries par une propagande totalitaire efficace.
Dans un passé pas si lointain, on entendait le grondement sourd et caractéristique des « Mirages », les célèbres chasseurs français opérant au Sahel. Aujourd’hui, ce sont les drones qui opèrent en silence et, après le départ des militaires français, d’autres militaires sont présents sur place. On trouve des mercenaires russes du groupe Africa Korps, plus ou moins connus, des soldats chinois chargés d’éviter les problèmes sur l’oléoduc dont ils sont propriétaires, des mercenaires turcs et quelques centaines de militaires italiens officiellement affectés à la formation de leurs homologues nigériens. En arrière-plan, cependant, subsiste la collaboration jamais reniée avec les forces américaines qui, entre autres, ont formé certains des militaires qui ont pris part au dernier coup d’État. La promesse d’éradiquer rapidement les différentes formations des groupes armés d’inspiration « djihadiste » s’est progressivement révélée être un mirage tragique qui continue de faire des victimes, militaires et civiles, dans la région du Sahel. Les cimetières et les deuils nationaux ne connaissent aucun répit.
Les drapeaux des trois pays fédérés du Sahel central, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, si nombreux et flamboyants au moment du coup d’État et lors des différentes étapes de la constitution de l’Alliance des États du Sahel (AES), sont désormais décolorés, effilochés ou oubliés aux ronds-points de la capitale. Même les tricycles qui, nombreux, arboraient fièrement le drapeau national, sont désormais surchargés de marchandises, de passagers et d’animaux destinés à l’abattoir. La promesse et l’ambition d’une souveraineté nationale rapide, totale et radicale, véritable « mantra » des régimes militaires des pays cités, cèdent progressivement la place à la perplexité, à la confusion et à la désillusion du quotidien, beaucoup plus complexe que prévu. Depuis deux mois, les fonctionnaires ne reçoivent plus leur salaire à terme échu, les prix élevés des produits de consommation de base et la fermeture obstinée de la frontière avec le Bénin voisin ont transformé tout cela en un mirage sans limites. Enfin, la démolition de magasins, de logements et d’ateliers informels a achevé le désastre social.
Malgré la rhétorique panafricaniste, monétariste et anti-impérialiste des pays en question, le mirage de l’Occident n’a pas disparu et des milliers de migrants et de demandeurs d’asile sont désormais « parqués » dans des centres d’accueil et de transit insuffisants. Les expulsions systématiques et inhumaines menées par les militaires algériens, tunisiens et les milices libyennes ne laissent aucune issue à ceux qui deviennent les otages d’un système de traite des êtres humains. L’isolement diplomatique et économique du régime, qui a rompu ses relations avec de nombreuses organisations internationales, a entraîné une forte réduction de l’aide extérieure. Même les « puissances humanitaires » telles que le Haut-Commissariat pour les réfugiés et l’Organisation Internationale pour les Migrations des Nations unies sont en difficulté financière, ce qui a des répercussions dramatiques sur les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. L’illusion de gérer ces mouvements de personnes avec humanité s’avère être une mission impossible. Le pays accueille des milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays.
Pour convertir les mirages, il n’y a pas de meilleure thérapie que la réalité qui, comme on le sait, est subversive. Appeler les choses par leur vrai nom est un geste révolutionnaire, écrivait Rosa Luxemburg, philosophe socialiste.
Mauro Armanino, Niamey, juillet 025