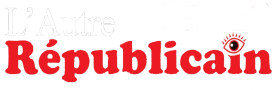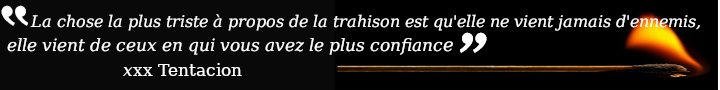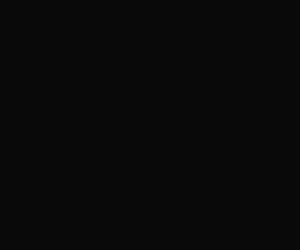Il n’y a pas d’assiégés sans assiégeants. Les uns vont de pair avec les autres et il n’est pas toujours facile de définir les frontières entre ces deux réalités complémentaires. Si l’on considère l’histoire humaine comme une lutte des classes, on pourrait également l’interpréter comme un antagonisme entre opprimés et oppresseurs, ou encore entre assiégés et assiégeants. Le récent et énième drame qui, ces derniers jours, a contribué à allonger la liste des morts en mer Méditerranée au large de Lampedusa, rend cette distinction difficile, voire impossible. Qui, dans ce cas, étaient les assiégés ou les assiégeants ? La question reste ouverte selon le point de vue à partir duquel on lit les événements et les mots utilisés pour les décrire. Au nord du Sahel se trouvent le désert du Sahara, le Maghreb, la Méditerranée comme « Mare Nostro » et enfin les premiers signes de l’Europe méridionale. Il faut préciser ou conjurer à chaque fois qui assiège et qui est assiégé !
Le siège est compris comme une opération d’encerclement d’un lieu afin d’en empêcher la sortie ou l’accès. C’est le cas de nombreux villages et villes du Sahel central comme dans d’autres régions du continent. Ils sont littéralement encerclés par des groupes armés de type « djihadiste », souvent associés au banditisme qui vise à s’accaparer des biens, des ressources, des armes et de la drogue. Dans ces cas, tout se complique, notamment en raison de la pénurie de biens de première nécessité et, en particulier pour une partie des jeunes, l’adhésion à des groupes armés devient l’un des moyens possibles de survivre. Le siège s’impose comme une forme particulière de violence où la présence de l’État brille par son absence. Appliqué parfois pendant des années, il est capable de changer la vie économique, sociale et politique de portions entières du continent. Parfois, les assiégés et les assiégeants semblent se définir avec des contours bien précis.
Autour de la Méditerranée se trouve l’autre drame innommable de la terre de Gaza, en Palestine-Israël. Les assiégés et les assiégeants, encore eux, semblent se définir facilement, si l’on veut être honnête avec la réalité, pour ceux qui incarnent l’un ou l’autre. La citation de Marek Edeleman, l’un des chefs de la résistance, assiégé dans le ghetto juif de Varsovie par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, est éclairante. David Rosemberg, dans un discours prononcé en 2017, conclut par les mots d’Edelman, déclaré persona non grata en Israël. Il affirmait textuellement… « Nous nous battons pour la dignité et la liberté. Pas pour un territoire ou une identité nationale… Être juif, c’est toujours être du côté des opprimés et jamais du côté des oppresseurs ». L’assiégé peut se transformer au fil du temps et selon les circonstances en assiégeant, et celui qui était persécuté en persécuteur.
Ces mutations bien connues traversent notre histoire personnelle et collective. L’Europe, continent « migrant », s’est progressivement transformée en terre d’accueil pour les immigrants. En Italie, entre 1876 et 1915, la « grande émigration » a vu partir environ 30 millions de compatriotes, dont une partie est ensuite revenue au pays. L’Europe déclarée en état de « siège » par des forces politiques qui complotent et attisent la peur parmi les citoyens était la même qui « assiégeait » d’autres continents, pour le travail et surtout avec le colonialisme. La frontière entre assiégé et assiégeant est floue et traverse chaque personne, chaque société et chaque civilisation. Tout comme celle entre opprimé et oppresseur, colonisé et colonisateur, car, comme le rappelait Frantz Fanon, martiniquais naturalisé algérien, le colonisateur se cache parfois dans le colonisé. C’est pourquoi certains choisissent de toujours et en tout cas se ranger du côté des opprimés.
Mauro Armanino, Casarza Ligure, août 2025