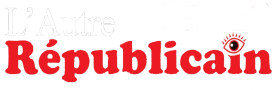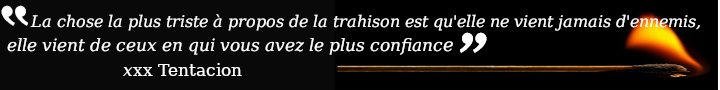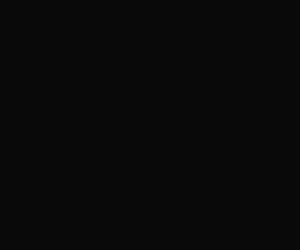En application des dispositions de l’article 68 de la « Petite Constitution », l’Ordonnance n°2025-07 du 18 avril 2025 a été signée. Son objet est de définir les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Consultatif de la Refondation (CCR) en lieu et place du Conseil Consultatif National annoncé à l’article 12 de l’ordonnance n°2023-02 du 28 juillet 2023 portant Organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, abrogée.
En vue d’opérationnaliser cet organe et conformément à l’article 5 de l’ordonnance n°2025-07 susvisée, il a été procédé à la nomination de 189 conseillers par décret en date du 1er mai 2025.
Sur la forme, l’on constate que ces conseillers proviennent d’horizons divers. L’on compte, en effet, des représentants des 63 départements du pays et de la Ville de Niamey, des représentants de la diaspora, des acteurs de la société civile, des représentants des forces de défense et de sécurité en activité et à la retraite ainsi que celles de leurs épouses, des chefs traditionnels, des religieux, quelques anciens ministres, des représentants de certaines couches socio professionnelles à l’exception des universitaires es qualité, des magistrats, des avocats…
Aux termes de l’ordonnance précitée, les conseillers sont repartis en bureau dont les membres sont nommés par décret et en six (6) commissions disposant chacune d’un Président, d’un secrétaire et des membres désignés par le bureau du CCR.
L’économie de l’ordonnance n°2025-07 du 18 avril 2025 et du décret portant nomination des conseillers permet de comprendre que le CCR a la particularité de bénéficier des axes d’intervention assez variés (I) mais dépourvue de toute portée juridique contraignante (II).
- Des axes d’intervention variés…
Dans un Etat, la création d’un organe ou d’une institution pose nécessairement la problématique du contenu et de l’étendue de sa mission. Celle-ci renvoie à sa raison d’être ou au but principal de son existence. Il lui est, à ce propos, confié un ensemble de tâches dans le but d’atteindre des objectifs précis. Les domaines d’accomplissement de ces tâches sont tantôt restreints tantôt larges d’où la distinction entre la compétence d’attribution et la compétence générale d’une institution.
Concernant le CCR, l’ordonnance n°2025-07 semble retenir les deux formules. En effet, en créant les six (06) commissions thématiques couvrant des domaines certes variés mais limitativement énumérés, l’on pourrait conclure que l’ordonnance a entendu circonscrire le champ d’intervention du CCR. C’est ainsi qu’il est habilité, au regard de l’article 13 de l’ordonnance précitée, à opiner sur les questions de paix, de sécurité, de réconciliation nationale et de cohésion sociale, sur la refondation politique, culturelle et institutionnelle, sur l’économie et le développement durable, sur la géopolitique et l’environnement international, sur la justice et les droits de l’homme et enfin sur la santé, l’éducation et les affaires sociales. Il s’agit, au fond, de la reprise des thématiques issues des Assises nationales.
A cette liste exhaustive qui semble prendre en charge l’essentiel des préoccupations de la société et qui rappelle, à tout point de vue, l’idée de compétence d’attribution s’ajoute une formule non moins anodine prévue aux articles 1er et 2 infine de l’ordonnance n°2025-07. Elle permet au CCR d’intervenir « sur toute question intéressant la vie de la Nation… ». Il s’agit d’une formule qui est généralement insérée dans un texte juridique pour palier le risque d’oubli ou d’omission lorsqu’il a été choisi de procéder à l’énumération des principaux domaines de compétence de l’organe ou de l’institution.
Ainsi, au-delà de ces six (6) thématiques énumérées à l’article 13 de l’ordonnance 2025-07, le CCR est fondé, en application de la disposition susvisée, à se prononcer sur toute question intéressant la vie de la nation ; ce qui étend considérablement son domaine de compétence.
L’intervention du CCR, dans ces différents domaines, est tantôt provoquée par la saisine du CNSP ou du gouvernement, tantôt spontanée lorsque c’est le CCR lui-même qui en prend l’initiative. Quoi qu’il en soit, elle prend la forme d’avis, de proposition ou de recommandation ôtant ainsi tout caractère contraignant formel à son intervention.
- … dépourvue de toute portée juridique contraignante
Le CCR donne son avis…sur toute question…dont il est saisi. Le CCR peut faire, de sa propre initiative, toute proposition ou recommandation…sur toute question intéressant la vie de la nation. Les dispositions des articles 1er et 2 de l’Ordonnance 2025-07 ainsi rappelées précisent les modalités d’intervention du CCR.
Elle prend la forme d’avis lorsque l’intervention est provoquée par le CNSP ou le Gouvernement et celle d’une proposition ou recommandation lorsqu’elle est spontanée c’est-à-dire à l’initiative du CCR lui-même.
Dans le premier cas, il faut, tout de suite, souligner que l’avis d’un organe consultatif peut être facultatif, obligatoire ou conforme.
Il est facultatif lorsque l’autorité investie du pouvoir de décision est libre de le solliciter ou de ne pas le solliciter tout comme elle est libre de le suivre ou de ne pas le faire. L’avis est obligatoire lorsque l’auteur de la décision est obligé de le solliciter même s’il n’est pas tenu de le suivre. Ces deux types d’avis constituent des opinions données à la demande d’autrui. Ils sont requis non pas pour se soumettre à la volonté de celui qui les émet mais pour s’enrichir de sa pensée, à la rigueur pour se laisser séduire par elle. Quant à l’avis conforme qui crée une situation de codécision, il faut dire que l’autorité est tenue non seulement de le solliciter mais aussi de le suivre.
En l’espèce, l’on peut aisément conclure que les avis du CCR ne sont ni conformes ni obligatoires. Ils ne sont pas conformes car, en droit, l’avis conforme ne se présume pas. Il doit avoir été expressément précisé par le texte qui le prévoit. Il n’est pas non plus obligatoire car si le CCR est tenu de donner son avis lorsqu’il est saisi, force est de reconnaitre qu’une telle saisine reste et demeure à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de décision.
L’avis du CCR est facultatif et dépourvu de toute valeur juridique susceptible de contraindre l’auteur de la décision. Celui-ci est libre de le demander ou de ne pas le faire ; de le suivre ou de ne pas le faire. L’on comprend dès lors qu’il s’agit d’une opinion susceptible d’être sollicitée dans le seul but d’éclairer l’autorité sur les enjeux et les risques liés à la décision à prendre.
Dans le second cas, il est de notoriété publique que la proposition et la recommandation susceptible d’être formulée par le CCR, lors de ses sessions ordinaires ou extraordinaires, ne sont que des conseils ou de suggestions portés à l’attention de l’autorité investie du pouvoir de décision.
En somme et à la question de savoir s’il faut considérer le CCR comme un géant institutionnel au pied d’argile, l’on peut tenter de répondre par l’affirmative et pour au moins trois raisons :
- Le statut juridique des conseillers est peu enviable. En effet, bien que certains auraient été élus ou désignés par les structures qu’ils sont censés représentés au sein du CCR, il apparait, au regard de l’ordonnance, qu’ils sont dépourvus de tout mandat. Leur nomination tout comme leur révocation sont à la discrétion du Chef de l’Etat. Ceci constitue une sorte d’épée de Damoclès les plongeant dans une précarité juridique. Est-il possible, dans ces conditions, de faire valoir certains points de vue gênants dès lors que l’on tient à son titre de Conseiller surtout lorsque les discussions et débats sont publics ?
- A priori, le profil de certains conseillers n’est pas en adéquation avec l’étendue et la subtilité de la mission à eux confiée. Il s’agit, en effet, de donner des avis, de formuler des propositions ou des recommandations sur des questions stratégiques dans un contexte très particulier. Or ces avis, propositions et recommandations ne peuvent être pris en compte que lorsqu’ils sont pertinents, innovants et adaptés. Pour qu’il en soit ainsi ces avis, propositions et recommandations doivent avoir été formulés ou donnés par des personnes suffisamment outillées et expérimentées dans les principaux domaines énumérés dans l’Ordonnance 2025-07. Le recours à l’Intelligence Artificielle n’est pas de nature à combler certaines carences. C’est pourquoi, l’on dit, souvent que si juridiquement l’avis, la proposition ou la recommandation ne lient pas l’autorité investie du pouvoir de décision, leur pertinence ou le profil de la personne ou de l’organe qui les émet peut les imposer. Dans ce cas, l’autorité n’aurait d’autres choix que de les suivre et de les mettre en œuvre. C’est en cela que le choix du profil des conseillers revêt tout son intérêt.
- L’installation d’un CCR dépourvu de tout pouvoir de décision laisse intacte toute la problématique de la séparation des pouvoirs dans ce contexte dit de refondation.
A la limite, le CCR n’est-il pas réduit à un simple organe godillot ?
Dr. Adamou ISSOUFOU
FSJP/UCAD