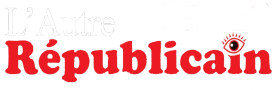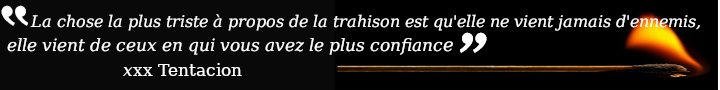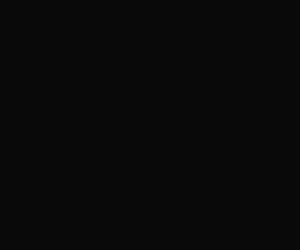À l’heure où l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES) cherche ses repères dans un monde en perpétuel bouleversement, une lueur d’espoir et de réflexion a jailli au sein de la salle de conférence de l’Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH), le jeudi 26 juin 2025. Une conférence publique, organisée par l’IRSH et l’Université du Bien Commun (UBC), avec le soutien de l’Agence Italienne de Coopération au Développement (AICS), s’est tenue sous le thème d’une brulante actualité : « Citoyenneté et civisme dans l’espace AES ». Une rencontre de haut niveau, portée par des esprits engagés, face à un public résolument attaché à la refondation des valeurs fondamentales dans les sociétés sahéliennes.à
Dès l’ouverture, les mots de bienvenue des représentants de l’IRSH, de l’UBC et de Nexus ont planté le décor. Dans un langage limpide et de conviction, ils ont rappelé les objectifs de cette conférence qui consiste à enraciner les sociétés sahéliennes dans une citoyenneté responsable active, éthique et inclusive. Loin des slogans convenus, les propos liminaires ont souligné la nécessité urgente de reconstruire le lien civique et d’encourager le dialogue au cœur des sociétés éprouvées par les conflits, les replis identitaires.
Modérée avec rigueur par le Professeur Issa Abdou et en regardant régulièrement son chrono pour le respect du timing, la conférence a donné lieu à des communications riches, éclairées par des références philosophiques, historiques et sociopolitiques.
Le Professeur Halidou Yacouba, de l’Université Abdou Moumouni, a ouvert les échanges en revisitant les fondements de la citoyenneté. En huit points clairs et pertinents, il a défini les concepts clés : citoyen, civisme, droit, devoir, souveraineté, unité nationale… en précisant sur le fait qu’aucune loi n’est intangible sans la volonté du peuple : il a évoqué Platon, Rousseau, Frantz Fanon et d’autres philosophes contemporains pour étayer son propos. Il a évoqué l’engagement des sociétés civiles, la place de la jeunesse, et l’importance du genre dans l’édification d’une citoyenneté juste et équitable. Professeur Yacouba devait préciser que le point de convergence majeur entre la citoyenneté et le civisme réside dans leur ancrage politique et leur relation avec les droits et les responsabilités des individus au sein d’une société, visant le bien commun. La citoyenneté définit la condition de membre d’une communauté politique, avec ses droits et devoirs, tandis que le civisme incarne l’attachement et le dévouement du citoyen envers cette collectivité et ses règles. Il conclut en citant Seydou Badian, dans Sous l’orage : « L’homme n’est rien sans les autres. »
Le Docteur Abdoul Kader Koini, également de l’UAM, a centré le débat sur la citoyenneté légale et active. À partir de l’acte de naissance, le mariage, il a démontré comment le citoyen entre dans la République, et comment il peut ou non exercer ses droits. Il a mis en lumière les liens étroits entre civisme et gestion des affaires publiques, dénonçant l’incivisme comme une entrave à l’État de droit, définissant ce fléau comme la négation volontaire des normes communes, des obligations morales et des devoirs envers la collectivité. La citoyenneté octroie des droits civils et politiques, et le civisme, quant à lui, met l’accent sur le respect de ces droits et l’accomplissement des devoirs correspondants pour le bien de tous.
En s’appuyant sur l’exemple des grandes contestations populaires, notamment celle de 1886 en Grande-Bretagne, il a plaidé pour un réveil citoyen capable de dénoncer pacifiquement les abus du pouvoir dans le respect des droits et des libertés.
Le dernier intervenant, c’est le journaliste Oumarou Lalo Keïta, membre de l’ONG SOS Civisme Niger, a livré une analyse implacable des trois défis majeurs qui plombe l’exercice de la citoyenneté dans le Sahel central. Il s’agit, selon le conférencier, du terrorisme, de la migration irrégulière et de l’extrémisme religieux. Sur le terrorisme, il a mis l’accent sur la désacralisation de la vie humaine, les déplacements massifs des populations, les pillages des ressources et l’effondrement du lien social. Il a souligné que dans un contexte d’insécurité chronique, il est illusoire de parler de citoyenneté, de développement, encore moins de civisme. Concernant la migration, il a dénoncé les traitements inhumains réservés aux migrants, notamment par l’Algérie, qui refoule régulièrement des Nigériens et d’autres ressortissants du Sahel et d’ailleurs dans le désert, dans des conditions indignes, bafouant leur dignité humaine. Enfin, sur l’extrémisme religieux, il a lancé un vibrant plaidoyer pour une coexistence pacifique, le respect des croyances et le pardon mutuel. Il a rappelé les douloureux événements survenus à Niamey et Zinder dans un passé récent après l’affaire Charlie Hebdo, qui ont ravivé les tensions interreligieuses. Pour lui, aucune croyance ne saurait justifier la haine de l’autre. Il a terminé sur une note d’espoir, en valorisant les actions de terrain menées par son organisation en matière d’éducation civique, de formation citoyenne et de sensibilisation au vivre-ensemble. A ce sujet, il a évoqué les actions menées sur la lutte contre les MDM (Mal information, Désinformation et Mésinformation), la promotion du dialogue interreligieux qui a été initié, par son organisation, pour la première fois au Niger, il y a près de 22 ans, la mise en œuvre des projets sur la cohésion sociale dans certaines régions du pays, etc.
Les échanges avec le public ont montré l’intérêt profond des citoyens pour ces problématiques. Questions, contributions, témoignages, propositions… Les interventions ont reflété une soif de compréhension, mais aussi un désir profond de changement. Les conférenciers ont su répondre avec clarté et engagement, renforçant ainsi la portée de leurs messages.
Cette conférence, dernière d’une série organisée dans le cadre du projet de Promotion de la coexistence pacifique et du dialogue interreligieux, marque un jalon important dans la réflexion collective sur la citoyenneté dans l’espace AES. Elle a posé les bases d’un nouveau contrat social entre les États et leurs citoyens, fondé sur la responsabilité, la justice et la participation active.
À l’heure où les sociétés sahéliennes sont à la croisée des chemins, ce genre d’initiatives mérite d’être soutenu, amplifié et pérennisé. Car plus que jamais, la paix, la citoyenneté et le civisme ne doivent pas rester des idéaux abstraits, mais devenir des actes quotidiens, portés par des citoyens debout, responsables et solidaires. Une photo de famille a immortalisé ce moment fort, prélude, espérons-le, à d’autres rendez-vous de réflexion collective et d’engagement civique.
Mahamadou Tahirou