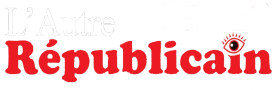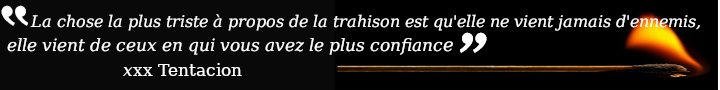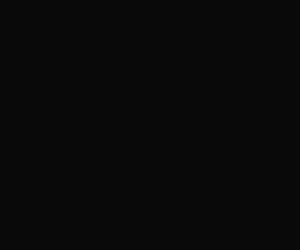Nous vivons de mythes, c’est-à-dire de récits ou de narrations qui offrent des explications crédibles de la réalité qui nous entoure. Ils sont caractérisés par des héros, des dieux ou des personnages fantastiques qui influencent l’interprétation du monde et dictent des choix, des comportements et des visions crédibles de la réalité. Chaque époque et chaque culture, même celles considérées comme « scientifiques » ou « technologiquement avancées », ont leurs propres mythes, évidents ou implicites, reconnus ou masqués par une rationalité apparente. Dans la vie réelle, ce sont les mythes acceptés ou subis qui orientent une grande partie des actions que nous accomplissons. Les mythes sont également ce qui peut manipuler la réalité afin de la rendre fonctionnelle au type de monde et donc de pouvoir que chaque récit perpétue.
En Afrique, l’un des mythes les plus répandus est celui de la durée « divinement voulue » des mandats présidentiels. La composante mythique du pouvoir, conçu comme l’expression d’une élection aux contours divins, laisse supposer que le chef ne recherche que le bien et la défense du peuple. Ce n’est pas un hasard si la durée des mandats, que les constitutions avaient opportunément réglementée pour éviter les abus de pouvoir, est prolongée ou modifiée. On change donc la constitution ou on invente des systèmes pour contourner ses limites, jusqu’à, si nécessaire, un coup d’État institutionnel ou un coup d’État armé. Ce dernier moyen ouvre la voie au deuxième mythe, tout aussi séduisant.
Celui de la violence et donc des armes qui aident à la mettre en pratique comme moyen de transformation ou de conquête du pouvoir. Derrière ce mythe se cache celui des sacrifices humains qui, à eux seuls, garantiraient les fondements de l’État, de la nation et de son identité. Les cimetières, les fosses communes, les monuments et les fêtes nationales ne sont que quelques-unes des expressions de ce mythe fondateur de l’histoire. La facilité avec laquelle les armes sont fabriquées, commercialisées, utilisées et prospèrent n’est pas fortuite. Le mythe de la puissance, né avec l’État et nourri par lui, n’a pas de mémoire. Le mois prochain, la première explosion atomique a eu lieu à Hiroshima en 1945. Cette tragédie est délibérément oubliée.
Les régimes militaires qui semblent accompagner la vie politique d’une partie importante des pays du Sahel sont également considérés comme une solution « mythique » à la corruption du système politique organisé autour des partis et des constitutions. Que ce soit l’uniforme, les armes conservées en réserve, la discipline apparente ou réelle qu’ils semblent incarner, les militaires comme moyen de salut pour le peuple s’affirment comme un autre mythe qui parvient à rassembler les idéaux, les jeunes et les aspirations endormies. La discipline et l’homme fort, dont le statut s’apparente à celui d’un shérif jumelé à l’idée du roi traditionnel, offrent aux militaires une réserve presque inépuisable de confiance de la part du peuple. Les mythes sont souvent et volontiers militarisés et armés.
Enfin, la nation, entendue comme un peuple qui s’identifie à un espace géographique et culturel choisi pour l’éternité, est l’un des grands mythes créés par la modernité. Les frontières, les drapeaux, l’armée, la culture et la religion forment, ainsi pense-t-on, un tout homogène et cohérent, fruit d’une descendance mythique faite de héros, de navigateurs et de saints. Les compétitions sportives avec l’hymne national, chanté la main sur le cœur par les athlètes, représentent ce qu’il y a de plus émouvant dans la vie. La nation mythifiée s’affirme comme le seul cadre identitaire et la seule garantie pour jouir des droits inhérents au citoyen. Aux frontières, on fait l’expérience, souvent dramatique, de ce mythe national.
En effet, à la frontière, les ponts deviennent souvent des murs, des barbelés, des zones de non-droit ou de commerce transfrontalier. Les fleuves, les mers et les déserts se transforment trop souvent en cimetières sans surveillance. Le mythe qui en assure leur soutien symbolique semble avoir un avenir radieux. C’est pourquoi démystifier l’imaginaire hérité et faire des pauvres et des opprimés sa propre « patrie » est la seule voie à suivre.
Mauro Armanino, Niamey